Règne du paradoxe.
Icare est un cow-boy.
Le testament écrit par la rosée.
Le match de boxe.
Le je, le tu, le nous, le quoi dément.
Pourquoi les seins sont-ils des hirondelles ?
Le baobab a payé ses impôts.
Quelques rayons lasers.
Moi, le rebelle, je déchire d’abord votre drapeau.
L’ordinateur et le refus de vivre, mon frère le chaos, mon dernier sou.
La page la plus vraie manque à mon livre.
Le paillasson de l’âme.
On me dissout.
Un azur ronfle.
Une planète tousse.
J’ai fait un beau séjour dans un vagin.
On rêve trop, on s’arrache les pouces.
J’écoute : est-ce le séquoia qui geint ?
Je me censure afin d’être moi-même.
L’absurde bleu est mon meilleur ami.
Désincarné, désincamant, je t’aime, mon moi numéro 5 !
Qui a vomi
sur
Dieu portant son anus à la bouche ?
Colibri, colibri, reste un moment !
Je chauffe mon langage et je m’y couche : ce je-m’en-fous, ce pourquoi, ce comment…
Mon néant, vieux tailleur aux cent costumes en organdi, si je lui commandais une toge à l’ancienne ? Ô goûts posthumes !
Mon amour s’est assis sur son bidet.
Le papillon est mon agent de change.
Je ne connais aucune affinité entre le sang, l’amour, les trois vendanges, la symphonie.
Je voudrais profiter
du désarroi qui devient élégie.
Le réalisme règne dans
Pékin.
Comète, souviens-toi de notre orgie, de ces enfants qu’on jetait aux requins,
de ces noyés qu’on allongeait sur l’herbe, pour mieux leur arracher le cœur.
Patron pris en otage.
Adolescent imberbe.
Clavicule nouée sur chaque front.
La nature n’est douce que bizarre. À force d’insulter notre devoir, nous avons fait de la raison la tare, le pus, la syphilis.
Un tamanoir
sous les palmiers lentement se promène, comme un prophète imbu de sa grandeur.
Ennui, angoisse, rage, entrez en scène !
La mouche qui se tue, la pierre en pleurs,
la neige en feu, la boue qui s’humanise.
Ulysse est établi à
Manchester.
Le doute, j’en ferai mon entreprise.
Okapi commerçant, as-tu ouvert
pour les bourgeois du coin une boutique où tu revends tendresse et gros baisers ?
Soleil aléatoire.
Informatique.
Opticien, programmeur.
Sexes rasés.
Le philosophe invente une prothèse pour ce monde affaibli.
Je vais citer
Schopenhauer, en mangeant quelques fraises.
Je mets en œuvre un plan d’austérité.
Mon fils, c’est au napalm que je t’élève.
Hiroshima, j’aime les champignons, quand ils sont indigo.
Ma mort si brève, il faut ressusciter !
Nous nous baignons
dans quelles eaux, qui soudain se font plates pour n’avoir pas choisi leur océan ? Écriture pourrie jusqu’à la rate.
Bouddha, boudeur, boudin…
Si, en créant
je ne sais quel objet : une chemise,
un pas de vis, un col dur, un écrou,
je parvenais à surmonter ma crise…
Hamiet est chez
Maxim’s dans les frous-frous.
J’ai bu avec
Kafka le dernier verre.
Au travail mes amis : la pendaison !
Ayez la gentillesse de vous taire : aucun livre jamais n’est de saison.
Jésus-Christ, mon ami, as-tu vingt roubles, pour me payer ce soir une putain ?
Le corps est nul, l’esprit se voudrait double et le proverbe, on dirait qu’il s’éteint,
comme sous le crachat mes étincelles.
Pour le cancer, on cherche un débutant : le cou d’abord, puis la nuque et l’aisselle, le ventre, le thorax : on a le temps !
J’éprouve une douceur sous ma souffrance : est-ce un lilas qui veut me caresser ?
Shylock est employé au
Gaz de
France.
Au paradis, j’ai mon laissez-passer
car je suis avec
Dieu dans les affaires : il me donne 1 % sur l’au-delà. Épilepsie.
La dent qu’on doit extraire. Ô
Jeanne d’Arc, bois ton coca-cola ‘
Toute éloquence en poésie, en prose, est comme une jument qu’il faut saillir.
Je sens en moi séisme et ménopause.
La licorne est ministre des loisirs.
Capitale vidée.
La soldatesque a pris le
Graal, la
Toison d’or, l’anneau pour son butin.
Seul un monde burlesque m’est acceptable : un cinéma porno.
Lady
Macbeth, venez qu’on vous console : j’ai un choix de phallus en caoutchouc.
Fuir, je veux fuir la forêt des symboles et devenir banal comme le chou.
Salaire.
Offre d’emploi.
Chef de service.
Titulaire du bac : antihéros du cœur, du doute et de l’esprit qui glisse comme dans sa baignoire un hobereau
âgé de quatre-vingt-dix ans.
Salope, ma tendre muse, où sont mes coups de sang, mon sperme qui baignait toute l’Europe, l’Asie couchée, mon verbe caressant ?
Je suis l’ombre et le vent ; je suis la chiffe et ne reconnais pas l’identité.
J’ai le corps en béton, l’âme apocryphe ; je nais et je renais pour m’effriter
peau après peau, vertèbre après vertèbre.
Abstrait, concret, je ne vois de salut que dans le saint mépris.
Drôle de zèbre !
Le dérisoire avec le superflu,
je les marie en moi.
Beau capitaine, dans le naufrage on trouve sa raison.
Regard de sable et cervelle trop naine.
Je l’ai dans l’intestin, mon horizon.
Un bal.
Une industrie pharmaceutique.
Le marketing du siècle.
Export-import.
Téléscripteur, j’adore ta musique, comme la symphonie du coffre-fort.
Pour se rendre aux enfers avec
Orphée, il suffit de s’asseoir dans le métro.
La reine d’Angleterre est décoiffée.
Einstein, devant la mer, vous pensez trop :
soyez plutôt joyeux dans la lumière
de cet après-midi ; le soleil blanc
ressemble au linge frais.
Ma banque est fière :
j’aurai de quoi vieillir, mais sans talent.
Je ne veux pas d’exemple ni d’Histoire.
Mon siècle est une erreur, et le passé un chapeau claque au fond de mon armoire, bon pour la naphtaline.
Terrassé,
contredit, douloureux comme une chienne que vient de renverser un autocar…
Il n’est jamais de poésie qui tienne, quand on voudrait se pendre au nom de l’art.
Paul
Valéry — journée sentimentale — me montre le néant, qui est en fleur et qui porte avec joie ses cent pétales.
Le vu pour l’invisible est un malheur.
Watteau, le
Vol 40 pour
Cythère à cause du brouillard est annulé ; acceptes-tu, pour mon anniversaire, de peindre un autre amour ?
Il faut mêler
rêve et terreur, le meurtre et la mystique.
J’étais à
Saragosse un jour sans jour, où la pensée ressemble à ces moustiques qui vous crèvent les yeux.
Dans une cour,
vêtue de blanc, hilare, la marmaille découpait, sabre au clair, un vieux taureau.
Adolescents cruels, si je tressaille, c’est que nos jeux communs sont immoraux.
Faim d’absolu, comme une confiture que l’on étale sur son pain moisi.
Dieu ennemi de
Dieu, je n’en ai cure : être, pour moi, c’est rester insaisi.
Car je me joue à la roulette russe :
sang jusqu’aux murs, je sais que je me perds.
Je triche contre moi, la belle astuce :
il est sans roi ni cœur, mon faux poker !
Je ne vais pas à
Katmandu ; l’aorte
et la plèvre, je dois les explorer.
J’ouvre en moi-même une à une mes portes ;
ma chair protège mon instinct doré.
Freud au divan !
Le gros
Apollinaire à la chanson qu’il écrivait pour
Lou !
Je suis la lettre sans destinataire et je vous congédie, mes dieux jaloux.
Un abat-jour blessé, une commode où j’ai rangé quelques préservatifs, un livre nu, un oiseau à la mode, une caresse lente, un geste vif,
un vieux buvard qui rappelle une absence, un journal d’avant-hier, douze chapeaux mais il manque la tête, un air de danse, une philosophie à fleur de peau :
à la pensée je préfère l’outrage
et je vous interdis de protester !
Le subconscient n’est qu’un bout de fromage;
moi, j’ai perdu toute virginité.
Il faut haïr, et ma plume est méchante comme un renard.
Je t’offre mes jurons, femme qui m’intéresses par les fentes, idole à qui je prépare un affront.
L’homme est pour la nature une salive : il se fait tard pour un coup de torchon.
Mon attitude, on la veut positive ?
Venez, mes assassins : nous embauchons !
J’éprouve tant de mal à me comprendre, que j’en accuse encore l’univers…
Si vous grattez un peu, je suis si tendre et pur, sous la surface de mes vers.
Le vivant, le vécu ou le vivable. «
Alain, sois snob ! » me disait
Aragon.
La toile d’araignée, j’en fais ma fable.
La nuit, le jour : si nous les distinguons,
c’est que nous sommes dans l’erreur.
Verlaine claudiquait devant moi, pauvre clochard.
Vous m’offrirez ce pull-over de laine ?
Dans mon ricanement se cache un art.
Je voudrais être un peu de turbulence.
L’eau de
Cologne est douce à mon menton.
Cigarette ou whisky.
Je me dépense à devenir un objet de carton :
à qui m’achète, un service après vente garantit tous les jours ma propreté.
Azur, tu dois me verser une rente : sans ma chanson, serais-tu habité ?
Je suis un bout de plomb, une gazette qui se survit en perdant ses lecteurs, la clé sans cadenas, la prune blette que refuse en hurlant l’oiseau moqueur.
Un mécréant !
Mettez-moi les menottes.
Je vais sacraliser le tout-venant.
Voyez, l’antimatière, elle complote, et le neutron fait de nous ses manants.
Sois-moi fidèle, ô muse atomisée !
Mon embryon mûrit dans le formol, et je suis de moi-même la risée. «
J’aime les fous », dit
Nicolas
Gogol.
J’ai préparé un discours pour
Lénine ; ma tête roule : est-elle à toi,
Danton ?
J’ouvre un goulag pour les penseurs, vermine qui corrode l’albâtre et le béton.
Le dégoût, le soupçon, seules patries !
Il m’arrive de suivre un vieux canal ; mon cœur est mou, et les cerises crient dans le jardin au bien-être banal.
Amants perdus, fermez les dictionnaires : il est chômeur,
Fabrice del
Dongo ; et
Rodrigue, pompiste ou commissaire,
Français moyen, colporte les ragots.
Goethe, je crois, me devient inutile et je renonce à célébrer
Mozart.
Au fond de moi, je me découpe une île et je m’y cache seul.
Il se fait tard :
c’est qu’avec l’âge on devient un faussaire, à force de récrire un testament ; nul ne voudra le lire : on exagère son désespoir.
Je vais, me décimant
et découvre à ma vie une mesure de petite nausée.
Je suis poltron, j’ai peur, je rentre en moi et je ne dure que le soupir du chien devant l’étroit.
J’ai tout prévu : l’abcès, le cœur qui cède, l’hémiplégie, la lèpre, un prix
Nobel; rien en moi ne m’amuse : adieu l’aède !
Nous trouverons d’autres professionnels.
Mon
Ophélie, on change de théâtre.
Mon
Antigone, on brûle nos tréteaux.
Une biographie que l’on replâtre.
Ukase du pollen.
Second veto
du scarabée.
Fureur du chèvrefeuille.
Thomas
Mann m’a écrit : «
L’homme a rendu l’homme suspect. »
En vain je me recueille et cède à de nouveaux malentendus.
Il convient d’être simple : à chaque phrase il suffit d’un insecte et d’un pipeau, comme jadis car l’angoisse n’écrase que ceux qui portent l’enfer dans leur peau.
O clichés, lieux communs : la folle engeance !
Je reprends le poison et le fusil.
Chacun pour soi !
Je tue.
J’ai la malchance d’être à moi-même le bourreau nazi.
Mon âme aussi, on la nationalise, à la façon de ce chemin de fer, qui serpente là-bas sous les cytises.
Je ne suis plus
Roméo ni
Werther.
Le bifteck avant tout.
Je vote à gauche.
Je fais la queue devant l’éternité.
Tu me promets l’ivresse et la débauche, ô
République ?
Je vais t’exalter.
J’astique un vers, ma vieille casserole.
Je répare un sonnet, ce paravent.
Je suis un ébéniste et me recolle.
Je vous repeins quelques soleils levants.
Le pot de lait chez
Vermeer est mystique ; la mystique est chez moi un pot de lait.
Toucan, à qui faut-il que je t’explique : la merveille est gratuite ?
On se frôlait,
vodka en feu, dans les ports de la
Hanse.
Mensonges, souvenirs et faux baisers.
Un mort se lève, un pendu se balance; pour un fou rire on nous a tous gazés.
Je saute ainsi du coq à l’antilope.
Je n’ai jamais été l’adolescent
qui, boutonneux, s’invente quelque
Europe
où la pensée se lave dans le sang.
La sodomie.
Le contrôle des changes.
L’entreprise publique.
Les requins.
L’intérêt national.
Qui fait l’archange, fait la bête assoiffée.
Pour
Charles
Quint,
l’Empire avait de trop vastes frontières.
Mon univers à moi s’est rétréci.
La cocaïne rouge.
Un plant de lierre.
Un mot trop vénéneux.
Je suis assis,
décadent et multiple, sur moi-même, avec mes manuscrits pour m’étouffer.
Une attachée de presse.
Le système de
Descartes, pourquoi ?
L’autodafé.
Ode au corail.
Pavane à l’hippocampe.
Rondeau trop court pour la neige qui fond.
Puisqu’il ne peut voler, mon verbe rampe : on n’est pas compliqué chez les bouffons.
À celui qui veut vivre d’évidences, vingt-cinq ans de prison !
Un syndicat chez les ratons laveurs.
Trop de dépenses :
Molly,
Marie,
Minou,
Paule,
Erica.
Amis, divinisons la libellule ;
le pissenlit mérite un
Parthénon.
Je suis un taoïste, et je recule
au fond de moi, en refusant mon nom.
Je suis aussi le jouisseur, le pitre qui se mutile à bouche-que-veux-tu.
Mon poème indécent n’a pas de titre : il appartient à ceux qui se sont tus.
Ramasse-t-on la mûre et la méduse, le jour où le navire coule à pic ?
Devant la classe,
Arthur
Rimbaud s’abuse ; téléphonez, maître d’école, aux flics !
Je suis pour moi la plus dure menace : à aucun prix je ne dois m’accepter.
J’ai marché dans
Florence en pleine grâce.
New
York est mort sous mon ébriété.
Je ne veux pas de choix : mon seul message est dans le vin qui doit me transformer. Église, banque, on tournera la page : on ne m’a pas appris à mieux m’aimer.
Destin, hasard ?
Je ressens l’allégresse d’être l’écrit autant que l’écrivain.
Le
Mexique est pour moi la seule
Grèce, avec l’iguane au flanc de ses ravins.
Dieu m’envoie chaque jour des télégrammes : «
Sois plus aimable.
Stop.
L’homme a du bon. »
Il ne faut pas compter sur moi.
J’enflamme, j’agace, j’empoisonne : un vrai bubon.
Et pourtant, dans mon âme — ô mièvrerie ! — on rencontre un soleil qui n’a pas peur, un horizon qui n’a pas de scories, une plage sans fin où rien ne
meurt.
Pureté, mon démon, tu m’incommodes ; mon esprit te préfère un eczéma, la syphilis, le doute ou cet exode, police parallèle et cinéma.
Je suis le sac et la peau de banane.
Je suis le cric, le pneu et les dessous
que porte une prostituée, le crâne
de quelqu’un d’autre, une machine à sous.
Je suis le porte-plume et le bas-ventre, ne me demandez pas de qui ! la glu, le parapluie, le cercle sans le centre, le vieux fourgon, le livre le moins lu.
Je suis le cyclotron, la marchandise, le
Picasso volé, l’arbre tout nu.
Je suis la porcelaine qui se brise, le hold-up, la rançon et ce menu
qu’affiche un restaurant sur la colline.
Je suis le vide et l’espace comblé, le typhus, le cancer, l’aube câline sur l’océan, quand il secoue ses blés.
Je suis à pleines mains le seul non-être qui puisse proclamer qu’il se suffit.
Je suis le gant, la ceinture et la guêtre.
Je suis la tortue mâle du défi.
Alain Bosquet
Mars-avril 1983.
Paris.





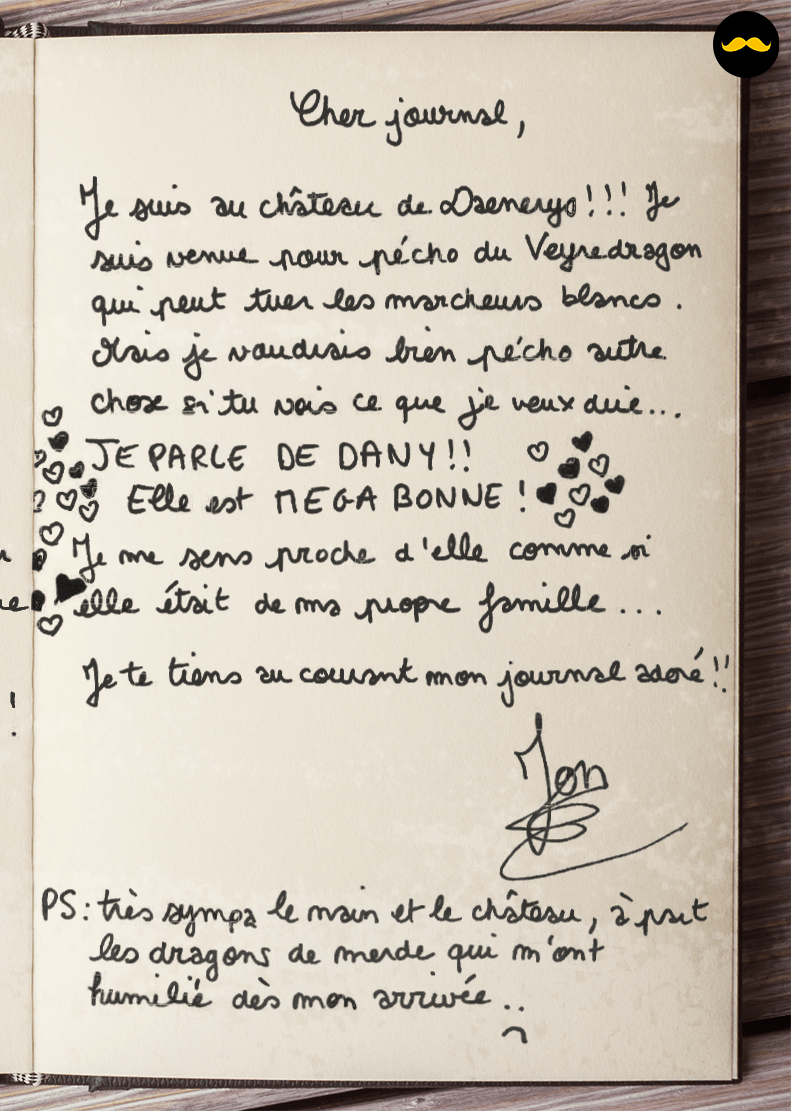
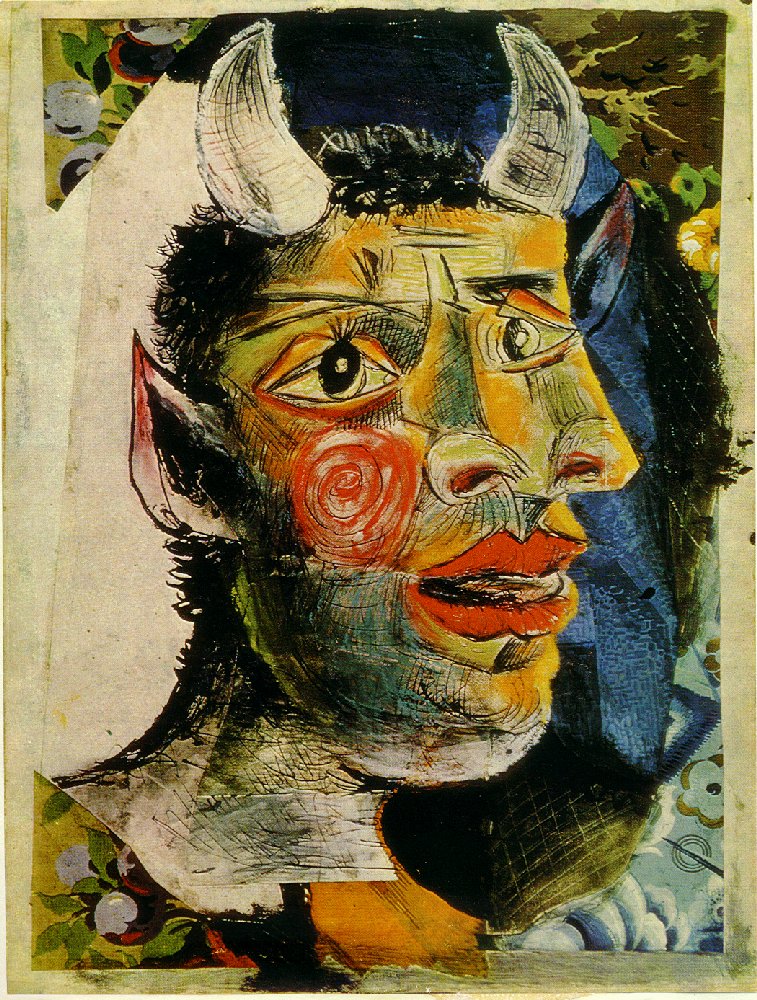




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.