Catégorie : LE JARDIN DE DE NIALA
« NATURISTES » – NIALA 21/02/24 – ACRYLIQUE S/TOILE 73X54

« NATURISTES »
NIALA 21/02/24
ACRYLIQUE S/TOILE 73X54
Au sauvage de la côte
les pins se penchent
en balançant leurs pommes
comme tu fais de tes seins offerts aux vagues
pareil pour moi en nageant mon genre dedans
Monte à franchir au-dessus du ciel
la sensation d’être noueux à la vigne sans la feuille
animalement rendu à la nature…
.
Niala-Loisobleu.
21 Février 2024
lA CHAMBRE PAR ILARIE VOLONCA (1939)

RICHARD DIEBENKORN
La Chambre
par ilarie volonca (1939)
À Colomba.
Je vais te parler des chambres où nous avons vécu. Des chambres que nous n’avons fait qu’apercevoir dans un rêve. Des chambres d’un jour; des chambres d’un mois; des chambres d’une année. Des chambres froides où nos mains se cherchaient effrayées et glacées. Des chambres étouffantes donnant sur une mer tropicale. Des chambres silencieuses comme des tombes. Des chambres bruyantes comme des foires. Chambre blanche de Raguse, les murs sont de vastes miroirs pour le sommeil mouvant des vagues. La craie des mouettes écrit des mots magiques sur le tableau noir de notre souvenir. Chambre vieille de Vienne, sentant le moisi et le renfermé; je suis couvert de sueurs dans le lit et j’ai froid et tu appelles affolée un médecin. Chambre terrible, chambre déserte de Soubolitza en Yougoslavie où notre cœur se déchire entre le désir de retourner en arrière et celui d’aller plus loin. Il n’y a que quelques brindilles pour le feu, et le froid est si grand que nos voix sont comme des morceaux de glace dans nos bouches. Chambre de Venise pesante, lourde comme un tapis plein de broderies et de monnaies anciennes; la mer comme une tireuse de cartes fait sa réussite multicolore. Chambre au baldaquin haut de Pavie, les murs ont un regard de pierre. Chambre de Kaspitcheak en Bulgarie, sentant la terre fraîche et le fumier. O! Chambre vaste et lumineuse de tes parents dans le quartier sud de Bucarest, la nuit comme une main chaude, le dernier fiacre qui s’en va en rêvant sous les fenêtres. Et la chambre inhospitalière dans cet hôtel de Berlin. Et ces chambres qui sont la seule chose que nous avons connue d’une ville; chambre de l’hôtel de Varsovie où les bras des neiges nous ont enlacés et où nous sommes restés de minuit à sept heures du matin. Chambre de Zagreb où par la fenêtre se dessinaient les montagnes. Nous avons rêvé de monter sur les cîmes et de crier au soleil: Hé, nous voici, Soleil! Mais nous n’y sommes jamais revenus. Chambres de Nantes, de La Rochelle, de Bordeaux, du Havre et ô! les chambres de Paris où nos années sont restées comme en des coffres secrets: chambre désolée et vide de la rue Brancion, chambre comme une plage dévastée de la rue Jonquoy. Chambres étroites comme des cercueils où la voix des voisins était haineuse comme la voix des morts. En Suisse, à Vevey, nous avons passé une nuit dans une chambre de vivants; les draps étaient très blancs et à travers les rideaux le lac nous invitait vers son ciel noble. La matin le bon café et le beurre, les confitures ô! belle aube de Suisse. Mais je tremble, une main serre mon cœur comme une éponge. J’entends mon sang qui coule goutte à goutte dans une grotte: je vois la chambre d’hôpital, tu es là après l’opération, tu as un regard si bon, si doux, tu me pardonnes de t’avoir menée dans cette salle hostile. Ta voisine est une petite fille, en face il y a une femme qui te ressemble et son mari qui me ressemble, ils se tiennent les mains, ils ne se disent rien, ils se regardent, c’est peut-être nous-mêmes car nous aussi nous nous taisons, nous nous tenons les mains, nous nous regardons. J’ai peur et je cache ma peur. Dehors les peintres sont en train de peindre les murs, ils sont habillés de blanc, les infirmiers aussi sont habillés de blanc, ce sont peut-être des peintres eux aussi et ils blanchissent à la chaux nos âmes. Quand je m’en allais je rôdais autour de l’hôpital et j’emportais en moi la chambre avec ses lits et ses malades comme un tiroir dans une armoire. Ô ! Il y a aussi les chambres trop vastes qui dépassent les frontières du monde, et celles qui tombent comme des navires au fond de nous et celles où l’on aime revenir pour retrouver son propre visage: Ai-je beaucoup changé? Il y a les chambres où je suis allé avec des femmes de passe et ton souvenir me faisait mal et donnait un goût très amer à l’amour, je fuyais ensuite par les rues et la chambre avec son odeur étrangère cognait les parois de ma tête et ne voulait pas s’en aller, ne voulait pas…
Chambre, je n’ai été en toi que quelques heures
Mais toi, tu resteras, toute ma vie, en moi,
Certes, nous sommes comme ces boissons qui gardent
Longtemps le goût de terre de la cruche qui les a contenues.
Les visages d’aucuns sont comme les cartes
Où se lit le dessin des chambres qu’ils habitent.
Il y a des chambres trop larges comme des pardessus d’emprunt
Il y a des chambres où l’âme doit se voûter comme un dos.
Il y a des chambres si aérées, si claires
Que rien ne les sépare des montagnes qui les entourent.
La forêt, les étoiles s’approchent des fenêtres,
On prend le thé avec des amis sur la terrasse.
Il y a la chambre où est enfermée ton enfance
Elle se méfie, elle ne te reconnaît plus très bien,
Il y a la chambre où ton père a été malade
Trois mois il a attendu la mort, et elle est venue.
J’ai passé à travers beaucoup de chambres
En les quittant je paraissais le même, mais les murs,
Les miroirs fumeux, les objets qu’enchaînait l’ombre
Gardaient, chaque fois, mon visage secret.
Ceci était ma chair et ceci fut mon sang
Versé de verre en verre, distribué à table,
Parfois je me surprends au milieu d’une chambre
Faisant le pas, le geste venant d’une autre chambre.
Il y avait une porte ici? Il n’y en a plus.
Et la fenêtre où est-elle donc? Il y avait
Un aboiement comme un linge à sécher dans la cour,
De l’autre côté du mur, une voix animée.
Mais ce n’est peut-être partout qu’une même chambre
Que l’on porte avec soi et qui s’adapte aux murs,
Dans les palaces, ou dans une mansarde, ou au fond d’une cave,
Elle sort de nous et recouvre tout de son étoffe.
Chambre qui donnait vers une cour sombre,
Chambre où résonne encore la voix de l’ami,
Lui, il est déjà moins qu’une ombre,
Mais sa toux, sans poitrine, s’affole en cette chambre.
J’ai connu aussi la chambre au retour de voyage
Et cette odeur de cuir et de départs,
La chambre entourée d’orages,
Et envahie par la mer de toutes parts,
Il y a vraiment des chambres qui ne veulent pas de vous,
Qui vous vont mal, qui vous tolèrent à peine,
Il y en a d’autres où l’on se sent à l’aise,
Le cœur tranquille, un livre ouvert sur les genoux.
Car il faut que l’on se mêle à la chambre,
Que l’on se perde en elle comme en un nuage,
Qu’il y ait entre vous et elle un courant continu,
Que l’on s’aime et que l’on se ressemble,
Alors l’âme déploie, confiante, sa lumière,
La chambre devient vaste ou étroite, selon votre désir,
Les murs sont affectueux et au-dessus du lit
Le plafond tend les toiles d’un sommeil paisible.
Ilarie Volonca (1939)
DE CI, DE LA

DE CI, DE LA
Du menton où la bouche est assise partent des directions choisies ou librement aventureuses que l’œil suivra sans intervenir
Au-dessus du pommeau de la canne la main assure l’équilibre
Les jambes ont envie marcher sur un chemin sec derrière le couvert des armes pour observer la parade amoureuse des oiseaux
Quand le premier train sifflera j’ouvrirais ma porte, des fois que celle qu’on attend toujours s’arrête à cette gare
Niala-Loisobleu.
11 Décembre 2023
L’ESSENTIEL PAR JACQUES BERTIN
LE RETOUR DU PRODIGUE PAR PHILIPPE DELAVEAU

LE RETOUR DU PRODIGUE
PAR
PHILIPPE DELAVEAU
Vous savez bien ces nuits très douces; les abeilles
Conspirent en silence dans la ruche du ciel
Au miel des blondes paix.
La lune
Est immobile.
Qui chuchote dans l’orme attentif?
L éternité jette a travers le siècle sa mésange
Qui nous tient éveillés.
Pendant un court instant,
Le cerf qui a sailli lève sa tête couronnée parmi
Les branches; l’étang laiteux ausculte le vestige
Sur le sang de l’argile où le renard a bu.
Mais vainement,
Icare tente de rassembler sur l’aile son plumage,
Et de pétrir la cire déchirée par le soleil jaloux;
Il darde de si haut cette colère.
Pour qui l’ordre
Sur la campagne plate cousue de bout en bout, avec les murs
Coupant le vent qui secoue l’or de ce qui meurt;
Les intrépides sont heureux de ce larcin, levant dans la
Ciélée leurs branches; d’autres, le bras trop court
Crachent dans l’eau qui réfléchit le ciel;
Septentrion lèche les
pans
Des toitures arides de sa bile, qui ne se plaignent pas.
L’absolu ne se contente pas d’un rapiéçage; l’emblavure
D’hiver seule parle du pays sous l’armure des neiges;
Il faut oser plus loin et haut, comme l’aigle céleste,
Plutôt qu’aux profondeurs du puits sur lequel l’arbre veille,
Où l’ingrate poulie jette sa voix geignarde, obéissant
Aux bras de la servante, ignorante du nombre, soumise aux lois
De la maison carrée dans le vent fort.
Et les fenêtres grimaçant dans la douleur des bois
Que la pluie gonfle, aimée du sol qui draine les vivants
Dans l’ombre où se défont les morts, mêlant les ongles
Et les vers, je les défie!
Et la bouche tordue, les jambes vaines,
Il tombe au bas du gouffre où les villages
Éteignent leurs fenêtres l’une après l’autre, cessant
D’attendre le retour du prodigue, fils oublié, fils
Ingrat, banni trois fois depuis les
Ides de novembre; et sa
photo jaunie
Se gonfle dans l’enclos des porcs qui le reniflent.
Le prophète
Annonce avec les premiers froids le retour imminent
De ce frère à demi voyageur, aimant l’horizontale des rivières,
Les carrefours baignant dans la lumière orange des banlieues.
Les mauvais coups, la fièvre dans les bouges; pleurant
Sur les ordures le nom de son village, son père avec un aiguillon
De sauge hâtant les bœufs sur le sol gras, avant
La pluie près d’assiéger, au loin, l’orangeraie grise de
Zabulon.
Sur la grand-route les peupliers alignent leur carrure
Pieuse, au chapeau bosselé, qu’agrémente l’épingle d’un corbeau noir
Moquant l’aurore aux pieuses liturgies.
Le maire
Et ses notables ne veulent plus de désordres
Qui heurtent la sobriété des bourgs paisibles.
Rien ne doit dissiper le pacifique agencement de l’heure,
Rythmée par les horloges, enregistrée dans les archives
Par l’employé qui tire en s’appliquant la langue sur le livre.
Il ne reviendra plus.
Le prophète se moque, disent les vieilles,
Debout sur le seuil obscurci, en fichu noir et rouge, de leur
bouche
Qui siffle : et que nous sert d’entendre l’oracle du
Puissant?
La soupe fume dans les salles, nous ne désirons rien.
La guerre
A fini par mourir comme le feu de branches, sous la petite
pluie.
Le vent se lève, mais les foins sont rentrés.
Nous avons fait nos comptes; les affaires vont bien.
Une banque
S’installe à l’entrée du village.
A quoi sert aux grenouilles de la douve, aux crapauds de
guetter
La route blanche qui se perd dans les complications de l’ombre?
Et si dans l’enclos l’étalon roux lève des yeux craintifs,
Il oubliera l’herbe à ses pieds, sans notable profit.
Seul le prodigue a vu dans le ciel une étoile qui hurle
Muette, tombant depuis des millénaires, suspendue
Entre les voies lactées, ténébreuses et froides, et l’arc
Des pluies tambourinant sur la vitre des mers; ne cessant de
lancer
L’invective que vomit son ventre, il a compris lorsque le soir
L’appelle en sortant de la ville, quel remords le poursuit;
Et lève en vain ses bras, que la cendre des nuits
Cache ma nuit rebelle, ma tête si coupable, mes mains
Qu’ébrèchent les écales des assiettes sur la décharge,
Où je ronge à genoux l’os rouillé du poulet, les épluchures
Liquoreuses, le fruit pourri, tombé de la table des riches.
J’accourrai, m’agenouillant de loin sur la terre vétusté;
Il ne saura pas même qui je suis, et je dirai quand les chiens
Pourchasseront le puant : ce jouet de bois qui traîne
Sur le sol du grenier, ce fut le mien, cheval qui m’emportait
déjà
Sur les foudres obliques des chemins.
Pitié pour moi, engen-dreur
De ma mort, ô père!
Et peut-être en pleurant la servante
ânonnant
Dans l’arrière-cuisine, aveugle, sur mon crâne
Reconnaîtra la chute, son effroi, en ces temps éloignés de nos
rires.
II
L’illustre maître de la moisson,
Qui pose une main large sur le flanc de l’épouse,
Et promène ses doigts vigoureux sur les brebis, est taciturne
Et triste en traversant les sillons parallèles; sous l’arbre,
La lumière pénètre dans la cave de l’ombre, violette sur les
feuilles
Accumulées.
Midi est l’heure des olives, du vin
Vieux qu’on boit la tête chavirée, les yeux clos en songeant
Aux bonheurs que l’été entremêle dans l’herbe,
Avec les crottes noires des lièvres bruns, les lents insectes
Qui aiguisent la chaleur sur le cuir des cailloux.
Il songe
A la splendeur du ciel, aux noms des rois et des étoiles,
A sa génération qui dort le ventre pénétré de racines,
De cailloux blancs qui se confondent dans le rêve
De la mer proche et bleue, agitée de courants, de tourbillons.
Pourquoi le brusque saut dans l’inconnu, cette part que l’on ôte
Aux communes splendeurs que l’on se passe de toujours, de
fils
En fils, sur le lit rude au moment de figer son regard
Sur les abîmes?
Pourquoi, sans prévenir, pendant l’aigreur de
l’aube
Qui sent le lait de chèvre, s’en aller, bousculant la servante
Qui balaie le dallage du corridor, et s’arrête soudain, surprise
Tenant de ses deux mains blanchies et crevassées par les lessives
Le bâton sur lequel sont arrimées les branches du fagot;
Par la porte le jour pénètre avec le cri des poules,
L’orgueil du coq sur le sommet du mur, et dans le ciel,
L’étrange signe d’une gloire, comme ces barbes qu’octobre
Arrache aux plantes d’or, semées de graines, expirant.
Plus que l’aile grandiose et morte des galaxies, le chemin
Arrêté dans les gouffres de la comète, il navigue
Entre la mort et la lumière, le gouffre et le froissement bleu
De la mer froide, présage illuminant le monde pacifique,
L’ordre des blés qui penchent leurs têtes victimales
Consacrées, même au petit matin, quand l’alouette s’envole
Après les premiers coups de l’aube sur l’horloge
De l’arbre, frémissant et disert.
Pourquoi?
Même en poussant
La porte qui racle les dalles, plus haut qu’elle, portant
Sa fortune sonnante dans un sac, sur une épaule, et lourd
De tous les songes qu’il n’a cessé d’assembler dans sa chambre À l’étage; elle sait bien qui écoute la nuit, le silence
Peset sur les toitures; connaît au loin les bruits réguliers
Des fontaines; l’ordre qui règne dans la pesanteur de l’étable,
Le chuintement des poulaillers, barrières closes; même le cri
Dans le vieux marronnier de la chouette ergotante, aux yeux
Fouailleurs; et la saveur très verte de la nuit, habillée de
Grenouilles que la lune très tard, loue doucement de sa lumière
Blanche et fait sortir des républiques de la boue.
Il allonge le pas et de la cour contemple dans le ciel
Alourdi du passage des oiseaux qui hantent les semailles,
L’autre qui tombe depuis des millénaires de défi,
Suspendu à la voûte du ciel comme la plume
Au roc, parmi la cendre, après que l’aigle
A fracassé sur le granit sa proie.
III
Il tombe infiniment, et voit
Son crime dans le chant bleu des gouffres qui l’aspirent,
Continue néanmoins de se moquer, dieu pour lui-même, s’ado-rant
Sur le miroir exubérant des abîmes déserts, seul, procréant
La mon qu’il se donne, libre (ou se croyant tel), grevé de
haine,
Plus solitaire que l’idolâtre
Qui vénère une tragique idée pour combiner le monde
Avec son rêve; son père, le tragique, en l’engendrant
A détesté ce fils servile que la gloire a tenté, comme lui
Qui s’est fait ange avec l’idée, la lumière et cette fausse neige
Des oiseaux qui traversent dans le vent rouge l’étendue,
Pour revenir aux terres antérieures.
Ils auraient bien gagné
Les terres oubliées, aimant l’ascèse; la matière,
Ils l’ont proclamée vile et le soleil s’approche
Comme un œil que l’on crève, alors, dans la nuit revenue…
Mais le soleil n’a pas voulu de ce théâtre, la lumière
N’a pu se résoudre à vivre désormais cachée.
Il me reste, dit-il, À te haïr pour ce mensonge.
Sur la terre, au petit jour,
Le père est généreux dont on se remémore
Des exemples sans fin de justice; il est un fils, ainsi,
Regrettant peu son frère, irréprochable et pieux, qui n’hésite
Jamais sur le devoir, et tient, le dimanche, à la grand-messe,
L’harmonium, avec la femme du notaire (contralte) et la vieille
Baronne aux cheveux teints (soprane).
Il n’a jamais omis de faire
Ce qu’il doit faire, et sur les prés, pour empêcher les vaches
De s’enfuir, il plante des piquets et des clôtures : c’est un très
bon
Garçon.
Nous nous passerons donc de celui qui s’exclut;
Chacun est libre, il a choisi.
Même il enlève
Sur la table dressée l’assiette de l’absent, nous aurons davantage;
Il épluche les noix entre ses sèches mains; s’essuie
L’extrémité des lèvres du coin de la serviette
Pour ne pas la salir; on le dit économe et le père a raison
D’en être satisfait : la servante, les bœufs, le cheval roux
L’ont adopté pour maître.
IV
Les routes ne furent jamais si longues; l’horizon
Jamais n’attiédit tant les terres aimées que l’on retrouve
Après les longs exils ; et des boules de gui décorent les trembles
Qui encadrent la route.
J’avais si faim mais je ne mangerai
pas;
Le ciel est bleu au-dessus de ma tête.
Pourquoi te résoudre à
rentrer,
Crie de sa prison transparente, de son enfer de feuilles,
Icare?
Il marche sur la douleur de son ombre effilée, tente
D’apprivoiser la douleur de sa tête, ses ongles douloureux.
Solitude,
Tel est le nom de l’ombre; il n’y a plus d’image dans mon
cœur;
D’eux je serai l’esclave puisque je les aime.
Avec les porcs,
Ils me tiendront dans la cabane aux auges débordantes ; comme la truie
J’aurai une génération de soupirs pour me plaindre et peut-être
Ils me diront : prends une place dans la boue,
Sur le fumier tiens-toi; les épluchures seront
Mon royaume de pénitent; l’aube froide
Sera mon seul toit; la nuit
Le dieu que je vénère, bras
Croisés sur mes os qui aspirent à rentrer
Dans le ventre animal de la terre,
Avec ma mère et ma lignée.
Ce père
Aux larges mains est ce que je connais de grand,
De terrible, de beau; sa voix est une profusion
De feuilles sur le vieil arbre.
Je lui dirai
Ce mot et peut-être ma nuit, il la réchauffera.
Quel est le père
Qui pardonne, a crié l’autre avec la grêle.
Donne aux pourceaux
Ton cœur; saigne tes veines dans l’orage : il n’est pas de torrent
Suffisant pour emporter les villes satisfaites.
Je veux aimer
Sans l’artifice de ton rire, ô malheureux et solitaire,
Sans l’œil du juge habile : je serai simple et pauvre, j’aimerai.
Avant même que ton frère approche, je l’ai vu;
Avant même qu’il me prévienne, je sais son retour.
Matin
Nimbé de gloire, l’aurore est douce, que le jour
Au chemin long et rude soit clément!
Fais dire à la servante
D’apprêter le veau gras; d’oindre de graisse la volaille
Qu’elle a plumée sur le seuil des cuisines.
La neige rousse tombe
Sur le seuil de la cour; et les légumes chantent sur le feu.
Ainsi
Le laboureur pressent à l’odeur de la terre, à la couleur
Du vent sur les bruyères, le retour du printemps
Que guident à la proue de son vaisseau, les hirondelles.
Fais dire à la servante de hâter son pas.
Nous irons convoquer
Les voisins, les notables.
Que le curé sur son échelle aille atteindre
Au clocher les bourdons qui entonnent
De quoi émerveiller le bleu de la campagne, et toute une
journée.
Que le maire abandonne l’inspection des fossés, le tour de la
commune;
Il mariera plus tard.
Va dire à la servante
De mettre sur la table une nappe si blanche
Que l’aube hésitera même à nous réveiller.
Je veux des fleurs, des feuilles, du houx vert, le gui
Des peupliers; enlevons le fumier où se vautrent les porcs.
Qui donc me balaiera la cour, les marches du perron?
Bouchonnez le cheval que j’aille sur la route,
Je veux être celui, malgré mes pauvres yeux, qui le voit
Le premier.
Les cailloux du chemin éreintent ses sandales.
Va dire à la servante d’étendre les tapis sur les cailloux aigus,
De préparer le bain, les huiles odorantes.
Qu’elle ouvre les
armoires,
Les fasse joyeusement grincer; je veux du linge neuf, des sachets
De lavande; une serviette onctueuse où le vent a rôdé.
Va dire
à la
Servante d’ôter son tablier : il n’y a plus, demain, de maître,
De servante; je crains les seules larmes sur mes yeux fatigués.
Saurai-je à sa venue m’agenouiller assez, le voir
De mes tremblantes mains, caresser sous mes doigts
Le grain de sa peau; sur ses cheveux trop longs.
Perdre sans fin mes lèvres?
Va dire à la servante…
Pourquoi cet œil si dur, ces lèvres serrées, ce pli sévère
Sur le front?
Vi
L’amour traduit l’épuisement des faibles; c’est leur arme.
Pardonner engage aux fautes plus terribles, rejoins-moi.
Les mâles
Ne sauraient nullement s’abaisser à des pensées coupables :
Courber le front devant celui qui t’a craché aux morts amères.
Rejoins-moi; la hauteur où je me tiens, je l’affirme sublime.
Le jugement impitoyable, de mon domaine sans pitié, je le jette
En châtiment aux sols qui ont cru pardonner, quand ils abandonnaient
La vieille loi.
Aime ce que tu édictés; comme la foudre
Aie la parole sans merci; défie le vieux faussaire
Qui parcourt en rôdant les campagnes honnies, l’exubérant,
L’aimé des houles et des pailles : soleil, je t’apprendrai ma
loi:
Je crèverai sans fin ton seul œil qui repère
La prière du juste et l’ennui du menteur.
Unissons la splendeur
De nos stérilités.
Laisse aux faibles le seul amour,
Source connue des désordres, feu qui ne réchauffe pas
Le froid où je grandis, yeux et cœur révulsés.
Mais tu
N’écoutes pas! et tu t’éloignes.
VII
Je ne lui ferai pas de reproches; ne dirai pas : je t’avais
Prévenu.
Je ne hausserai ni la voix, ni le sourcil.
Même saurai-je dire : fils? m’abstraire,
Etre infime, montrer que tout lui appartient — mon royaume,
Le nom, le temps et toutes les douceurs; l’implorerai.
Je me tiendrai mendiant dans l’ombre, à peine
Osant lever mes yeux faibles du côté qu’il se tient :
Je lui tendrai ma main calleuse, car il est riche.
Vois,
Si je possède ceci que tu désires, je suis ton pauvre qui mendie;
Je veux être le roi couvert de cendre, celui qui piétine la boue
Sans gémir, et pose sur la plaie sa main pour la guérir; et tu
Me guériras.
Mes vêtements ne sont pas douloureux
Pour ta douleur, ni assez beaux pour t’honorer, lorsque tu
paraîtras
Dans la fraîcheur du soir, vêtu de blanc et l’âme parfumée.
Pénètre en ta maison, et je courbe la tête.
Unis les cicatrices de tes joues
À mon visage vieux.
Viens t’endormir sur mon épaule,
Et sois l’enfant que je chéris.
Mais toi qui t’en reviens,
Pourquoi demeurer sur le seuil?
J’étais triste
Et tu m’as consolé; mais c’est lui qui m’a fait renaître.
Père j’étais, comme l’arbre impuissant pour ses feuilles qui
tombent;
Désormais, par sa grâce à mes mains l’appelant, je viens
De naître au plus profond, père éternel
Philippe Delaveau
EFFET BOEUF

EFFET BOEUF
Les prés de St-Germain
cavent sans vain
l’adolescence de mon enfance
où tes seins pointaient au déroulé du sax et de la trompette
Rien de lait dans le bidon
et tes cuisses en l’air au be-hop
bandaient mon arc au ciel comme l’âne devant le violet d’un chardon
Qu’un’ trombone passe dans ma tête en cet instant précis montre combien tout va mieux quand ça coulisse
La vie sans amour est l’avant-goût funèbre d’un aujourd’hui à pas laisser entrer foutre en l’air le bon fonctionnement de la nature
Vivre en corps ça par derrière me donne envie de brouter
Que l’herbe revienne sacré bon d’yeux…
Niala-Loisobleu – 29 Septembre 2022
DE MON JARDIN 1

DE MON JARDIN 1

PRIX DE VENTE AU DEPART DE L’ATELIER:
380,00 €
Le Jardin de Niala
9, Rue de la Chaume 16100 BOUTIERS-SAINT-TROJAN (Cognac)
le-peintre-niala@orange.fr
Passe-partout double-biseau anglais
Cadre Laqué blac et champ extérieur bois verni
UNE QUESTION AU POEME PAR MICHEL DEGUY

UNE QUESTION AU POEME
PAR MICHEL DEGUY
Orgue et naseau, nasaux d’orgues silencieuses
comme il arrive aux dessins de
Rubens, de
Watteau
que la ligne parfaite se reprenne si bien
que plusieurs dessins dune même chose
dessinent cette chose en surimpression d’elle-même,
cette nuit pour moi la face d’un cheval plus haut :
ruche du verbe frémir à dessiner
— l’ubiquité de bouche et de naseaux strobosco-
piques — je cherchais le mot juste pour cette pieuvre de contours des naseaux, je trouvai celui d’orgue et ne savais plus dans l’échange lequel était comme
Michel Deguy
LE TRONC DU PAUMIER
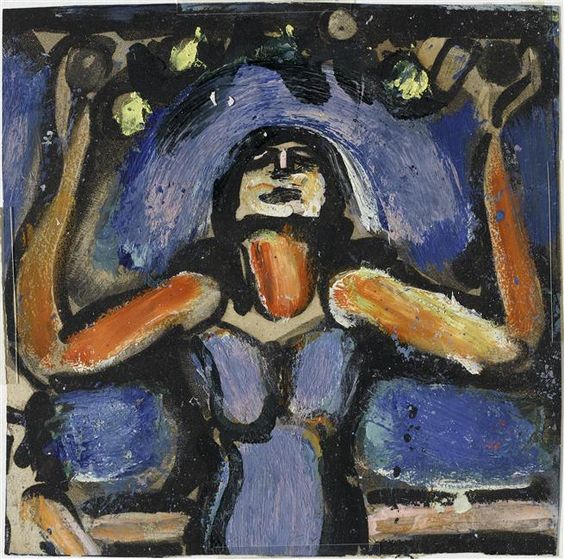
LE TRONC DU PAUMIER
Du compas où se trace ce parfum rond comme un premier verger, les prés verts faufilent à mots ouverts
Paroles qui rougaillent comme Jacques a dit ses Portraits
Clochardes à la peau fripée par le soleil d’une annonce automnale conduisant son veau à l’école des trains. pour se musculer l’imaginaire d’un ô riant express qui serpenterait en rivière non venimeuse
Des enfants gardiens de vaches à court d’école, la mer plus proche du château d’eau que de la javellisation domestique intellectuelle
Cache-cache
Tu contes jusqu’à sans et je sors du compte de faits label au bois-dormant
Porteur d’ô
Loin du raille d’Ouessant , à la rame de pois-de-senteur, s’intégrant dans un marathon de marguerites venues avant le dernier coup de cidre crêpe de chine
Courbes du tronc prises à demains, merci Georges.
Niala-Loisobleu – 13 Avril 2022

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.