A MES ENFANTS MORTS
LA FÊTE EST FINIE
Il est tard maintenant.
Me voici comme chaque soir
Claquemuré dans la cuisine où bourdonne une mouche.
Sous l’abat-jour d’émail dont la clarté pauvre amalgame
Les ustensiles en désordre, un reflet dur écrase
Ma page confondue aux carreaux passés de la toile,
Et la fenêtre penche au travers de la nuit où tous
Les oiseaux se sont tus, et les mulots sinon les branches
Que le vent froisse et ploie, et les plis des rideaux,
Et les remous de l’eau contre les berges invisibles.
Mais qu’est-ce qui s’agite et crisse en moi, plume d’espoir
Qui s’émousse comme autrefois quand j’écrivais des
lettres
Et que toujours plus flous des visages venaient sourire
En filigrane, exténués comme le sens des mots
Ordinaires : tu sais la vie est plutôt difficile
Depuis qu’Irène — ou bien ne me laissez pas sans
nouvelles.
Et pour finir ces formules sans poids qui me navraient.
Ton père affectionné, ma grande, et tous ces bons baisers
Au goût de colle, de buvard et d’encre violette.
Non, soudain c’est ma propre image qui remonte et flotte À la surface du papier, sous les fines réglures,
Comme le jour où chancelant sur le bord du ponton
Parmi les frissons du courant j’ai vu glisser en paix
Ma figure sans nom. —
L’identité du malheureux
N’est pas avec certitude établie — oh laissez-le
Dériver ; que son âme avec l’écume du barrage
Mousse encore, s’envole et vienne se tapir ici
Dans les fentes du plâtre et le grincement de la porte.
Alors comprendra-t-on pourquoi les jours se sont noyés
L’un après l’autre, jours divers, mais c’est toujours le
même,
Hier, demain, jamais, qui réapparaît aujourd’hui
Et qui me voit rôder de la cuisine aux chambres vides
Locataire d’une mémoire où tout est démeublé,
Où jusque sous l’évier s’affaiblit l’odeur familière
Et, par les dimanches passés au rideau poussiéreux.
L’illusion que tout aurait pu de quelque autre manière
Conduire à d’autres seuils — mais la même ombre
m’attendait.
Que reste-t-il dans les tiroirs : quelques cartes postales,
Deux tickets de bal, une bague et des photographies
Qui regardent au loin à travers de beiges fumées ;
Plus pâles chaque jour ces nuages du souvenir
M’enveloppent, j’y dors sans poids, sans rêve, enseveli
Avec ce cœur docile et ponctuel qui fut le mien peut-être, et qu’emporte à présent le rythme de l’horloge
Vers le matin du dernier jour qui va recommencer,
Déjà vécu, levant encore en vain sa transparence.
Si doux, ce glissement du train de banlieue à l’aurore (Quand de l’autre côté du carreau tremblant de buée
Le ciel vert et doré grandit sur la campagne humide)
Que c’est lui qui m’éveille aussi le dimanche et me mène
Jusqu’à l’enclos où j’ai mes tomates et mes tulipes.
Autour, dans la fumée et l’odeur aigre des journaux,
Songeant à d’autres fleurs, au toit de la tonnelle qui
S’effondre, mes voisins obscurs et taciturnes vont,
Convoi d’ombres vers la clarté menteuse du matin.
À cette heure malgré tant de déboires, tant d’années,
Je me retrouve aussi crédule et tendre sous l’écorce
Que celui qui m’accompagna, ce double juvénile
Dont je ne sais s’il fut mon père ou mon enfant, ce mort
Que je ne comprends plus, avec sa pelle à sable, avec
Sa bicyclette neuve, et son brassard blanc, son orgueil
Tranquille de vivant qui de jour en jour s’atténue
Entre les pages de l’album pour ne nous laisser plus
Que le goût d’une réciproque et lugubre imposture.
Muets, dépossédés, nous nous éloignons côte à côte,
Et ce couple brisé c’est moi : le gamin larmoyant
Que n’ont pas rebuté les coups de l’autre qui s’arrache À la douceur d’avoir été, quand le pas se détraque
Et que l’on est si peu dans le faible clignotement
De l’âge, sac de peau grise flottant sur la carcasse
Déjà raide et froide où s’acharne, hargneuse, infatigable,
L’avidité d’avoir encore un jour, encore une heure
Avant de quitter le bonheur débile de survivre.
Ne pouvoir m’empêcher de songer à ma mort (si fort
Parfois qu’en pleine rue on doit le voir à ma démarche)
Alors qu’elle sera la fin d’un autre dont la vie
N’aura été que long apprentissage de la mort :
Pourquoi cette épouvante et ce sentiment d’injustice ?
Qui te continuera, rêve d’emprunt d’où chacun sort
Comme il y vint, sans se douter que ce dût être si
Terrible de restituer cette âme qui faisait
Semblant de s’être accoutumée à nous ?
Je me souviens :
Un beau soir d’été dans la rue, est-ce qu’il souriait ?
Voici qu’il tombe la face en avant sur le trottoir.
Autour de lui beaucoup de gens se rassemblent pour voir
Comment il va mourir, tout seul, attendant la voiture,
Se débattant pour la dernière fois avec son cœur
Et son âme soudain lointaine où subsiste un reflet
De l’improbable enfance, un arbre, un morceau de
clôture,
Quelques soucis d’argent et peut-être un nom, un visage
Effacé mais qui fut l’unique et déchirant amour.
Et c’était moi qui m’en allais déjà ; ce sera lui
Qui mourra de nouveau quand viendra mon tour ; c’est
toujours
Tout le monde qui meurt quand n’importe qui disparaît.
S’il me souvient d’un soir où j’ai cru vivre — ai-je vécu.
Ou qui rêve ici, qui dira si la fête a jamais
Battu son plein ?
Faut-il chercher la vérité plus bas
Que les branches des marronniers qui balayaient le
square
Sous les lampions éteints, parmi les chaises renversées,
Quand le bal achevé nous rendit vides à la nuit ?
Les fleurs que l’on coupa pour vos fronts endormis,
jeunesses
Qui dansiez sans beaucoup de grâce au milieu de l’estrade
Au son rauque du haut-parleur, dans un nuage de
Jasmin, de mouches, de sueur, les yeux tout ronds devant
Les projecteurs cachés entre les frondaisons dolentes,
Les fleurs, las voyez comme en peu d’espace les fleurs ont
Glissé derrière la commode où leur pâle couronne
Sans musique tournoie avec les cochons du manège,
L’abat-jour en émail, les remous sombres du ponton.
Je ne revois que des cornets déchirés, des canettes
Dans l’herbe saccagée, et des guirlandes en lambeaux,
Et l’urne de la tombola brisée sous les tréteaux,
Et l’obscur espace du tir d’où plumes et bouquets
Ont chu dans la poussière.
Et voici les objets perdus
Dans le tiroir que personne après moi n’ouvrira plus
Pour réclamer en vain cette lettre qui manque, mais
Pour rire d’un portrait de belle prise dans l’ovale
Et levant d’impuissantes mains jusqu’à son dur chignon
Quel tenace et triste parfum d’oubli monte, s’attarde
Avec les cloches du matin qui rôdent sous les branches
Et la cadence de l’horloge au-dessus du réchaud.
Au loin dans le faubourg où finissent toutes les fêtes
Une dernière fois l’ivrogne embouche son clairon.
En bâillant, cheveux dénoués, la belle ôte ses bagues ;
Au fond de l’insomnie où m’enferme le bruit des mots,
Son épaule de miel est-ce le jour qui recommence,
Son silence l’espace où vont éclater les oiseaux ?
Il est tard maintenant.
Me voici comme chaque soir
Claquemuré dans la cuisine où bourdonne une mouche.
Sous l’abat-jour d’émail dont la clarté pauvre amalgame
Les ustensiles en désordre, un reflet dur écrase
Ma page confondue aux carreaux passés de la toile,
Et la fenêtre penche au travers de la nuit où tous
Les oiseaux se sont tus, et les mulots sinon les branches
Que le vent froisse et ploie, et les plis des rideaux,
Et les remous de l’eau contre les berges invisibles.
Mais qu’est-ce qui s’agite et crisse en moi, plume d’espoir
Qui s’émousse comme autrefois quand j’écrivais des
lettres
Et que toujours plus flous des visages venaient sourire
En filigrane, exténués comme le sens des mots
Ordinaires : tu sais la vie est plutôt difficile
Depuis qu’Irène — ou bien ne me laissez pas sans
nouvelles.
Et pour finir ces formules sans poids qui me navraient.
Ton père affectionné, ma grande, et tous ces bons baisers
Au goût de colle, de buvard et d’encre violette.
Non, soudain c’est ma propre image qui remonte et flotte À la surface du papier, sous les fines réglures,
Comme le jour où chancelant sur le bord du ponton
Parmi les frissons du courant j’ai vu glisser en paix
Ma figure sans nom. —
L’identité du malheureux
N’est pas avec certitude établie — oh laissez-le
Dériver ; que son âme avec l’écume du barrage
Mousse encore, s’envole et vienne se tapir ici
Dans les fentes du plâtre et le grincement de la porte.
Alors comprendra-t-on pourquoi les jours se sont noyés
L’un après l’autre, jours divers, mais c’est toujours le
même,
Hier, demain, jamais, qui réapparaît aujourd’hui
Et qui me voit rôder de la cuisine aux chambres vides
Locataire d’une mémoire où tout est démeublé,
Où jusque sous l’évier s’affaiblit l’odeur familière
Et, par les dimanches passés au rideau poussiéreux.
L’illusion que tout aurait pu de quelque autre manière
Conduire à d’autres seuils — mais la même ombre
m’attendait.
Que reste-t-il dans les tiroirs : quelques cartes postales,
Deux tickets de bal, une bague et des photographies
Qui regardent au loin à travers de beiges fumées ;
Plus pâles chaque jour ces nuages du souvenir
M’enveloppent, j’y dors sans poids, sans rêve, enseveli
Avec ce cœur docile et ponctuel qui fut le mien peut-être, et qu’emporte à présent le rythme de l’horloge
Vers le matin du dernier jour qui va recommencer,
Déjà vécu, levant encore en vain sa transparence.
Si doux, ce glissement du train de banlieue à l’aurore (Quand de l’autre côté du carreau tremblant de buée
Le ciel vert et doré grandit sur la campagne humide)
Que c’est lui qui m’éveille aussi le dimanche et me mène
Jusqu’à l’enclos où j’ai mes tomates et mes tulipes.
Autour, dans la fumée et l’odeur aigre des journaux,
Songeant à d’autres fleurs, au toit de la tonnelle qui
S’effondre, mes voisins obscurs et taciturnes vont,
Convoi d’ombres vers la clarté menteuse du matin.
À cette heure malgré tant de déboires, tant d’années,
Je me retrouve aussi crédule et tendre sous l’écorce
Que celui qui m’accompagna, ce double juvénile
Dont je ne sais s’il fut mon père ou mon enfant, ce mort
Que je ne comprends plus, avec sa pelle à sable, avec
Sa bicyclette neuve, et son brassard blanc, son orgueil
Tranquille de vivant qui de jour en jour s’atténue
Entre les pages de l’album pour ne nous laisser plus
Que le goût d’une réciproque et lugubre imposture.
Muets, dépossédés, nous nous éloignons côte à côte,
Et ce couple brisé c’est moi : le gamin larmoyant
Que n’ont pas rebuté les coups de l’autre qui s’arrache À la douceur d’avoir été, quand le pas se détraque
Et que l’on est si peu dans le faible clignotement
De l’âge, sac de peau grise flottant sur la carcasse
Déjà raide et froide où s’acharne, hargneuse, infatigable,
L’avidité d’avoir encore un jour, encore une heure
Avant de quitter le bonheur débile de survivre.
Ne pouvoir m’empêcher de songer à ma mort (si fort
Parfois qu’en pleine rue on doit le voir à ma démarche)
Alors qu’elle sera la fin d’un autre dont la vie
N’aura été que long apprentissage de la mort :
Pourquoi cette épouvante et ce sentiment d’injustice ?
Qui te continuera, rêve d’emprunt d’où chacun sort
Comme il y vint, sans se douter que ce dût être si
Terrible de restituer cette âme qui faisait
Semblant de s’être accoutumée à nous ?
Je me souviens :
Un beau soir d’été dans la rue, est-ce qu’il souriait ?
Voici qu’il tombe la face en avant sur le trottoir.
Autour de lui beaucoup de gens se rassemblent pour voir
Comment il va mourir, tout seul, attendant la voiture,
Se débattant pour la dernière fois avec son cœur
Et son âme soudain lointaine où subsiste un reflet
De l’improbable enfance, un arbre, un morceau de
clôture,
Quelques soucis d’argent et peut-être un nom, un visage
Effacé mais qui fut l’unique et déchirant amour.
Et c’était moi qui m’en allais déjà ; ce sera lui
Qui mourra de nouveau quand viendra mon tour ; c’est
toujours
Tout le monde qui meurt quand n’importe qui disparaît.
S’il me souvient d’un soir où j’ai cru vivre — ai-je vécu.
Ou qui rêve ici, qui dira si la fête a jamais
Battu son plein ?
Faut-il chercher la vérité plus bas
Que les branches des marronniers qui balayaient le
square
Sous les lampions éteints, parmi les chaises renversées,
Quand le bal achevé nous rendit vides à la nuit ?
Les fleurs que l’on coupa pour vos fronts endormis,
jeunesses
Qui dansiez sans beaucoup de grâce au milieu de l’estrade
Au son rauque du haut-parleur, dans un nuage de
Jasmin, de mouches, de sueur, les yeux tout ronds devant
Les projecteurs cachés entre les frondaisons dolentes,
Les fleurs, las voyez comme en peu d’espace les fleurs ont
Glissé derrière la commode où leur pâle couronne
Sans musique tournoie avec les cochons du manège,
L’abat-jour en émail, les remous sombres du ponton.
Je ne revois que des cornets déchirés, des canettes
Dans l’herbe saccagée, et des guirlandes en lambeaux,
Et l’urne de la tombola brisée sous les tréteaux,
Et l’obscur espace du tir d’où plumes et bouquets
Ont chu dans la poussière.
Et voici les objets perdus
Dans le tiroir que personne après moi n’ouvrira plus
Pour réclamer en vain cette lettre qui manque, mais
Pour rire d’un portrait de belle prise dans l’ovale
Et levant d’impuissantes mains jusqu’à son dur chignon
Quel tenace et triste parfum d’oubli monte, s’attarde
Avec les cloches du matin qui rôdent sous les branches
Et la cadence de l’horloge au-dessus du réchaud.
Au loin dans le faubourg où finissent toutes les fêtes
Une dernière fois l’ivrogne embouche son clairon.
En bâillant, cheveux dénoués, la belle ôte ses bagues ;
Au fond de l’insomnie où m’enferme le bruit des mots,
Son épaule de miel est-ce le jour qui recommence,
Son silence l’espace où vont éclater les oiseaux ?
Jacques Réda





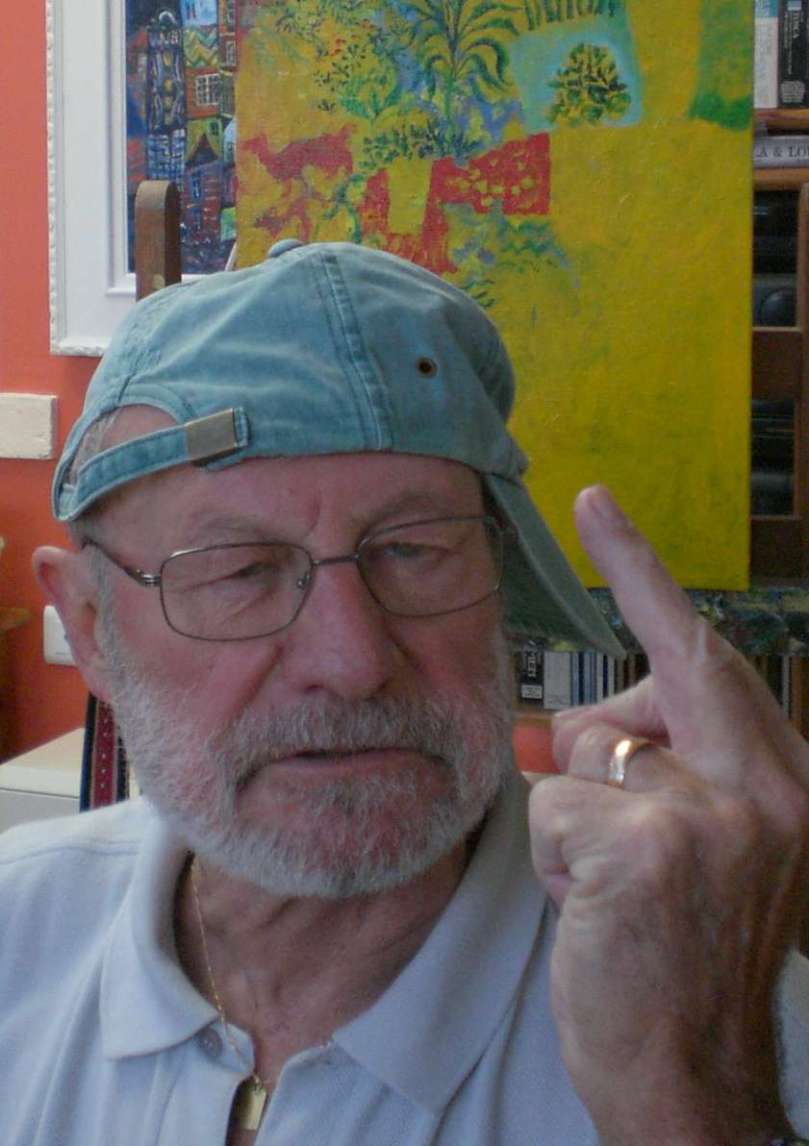




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.