Écoutez-moi.
N’ayez pas peur.
Je dois
vous parler à travers quelque chose qui n’a pas de nom
dans la langue que j’ai connue, sinon justement quelque chose, sans étendue, sans profondeur, et qui ne fait jamais obstacle (mais tout
s’est affaibli).
Ecoutez-moi.
N’ayez pas peur.
Essayez, si je crie, de comprendre : celui qui parle entend sa voix dans sa tête fermée ; or comment je pourrais, moi qu’on vient de jeter dans l’ouverture et qui suis
décousu ?
II reste, vous voyez, encore la possibilité d’un peu de
comique, mais vraiment peu : je voudrais que vous m’écoutiez — sans savoir si je parle.
Aucune certitude.
Aucun contrôle.
Il me semble que
j’articule avec une véhémence grotesque et sans
doute inutile — et bientôt la fatigue,
ou ce qu’il faut nommer ainsi pour que vous compreniez
Mais si je parle (admettons que je parle), m’entendez-vous ; et si vous m’entendez, si cette voix déracinée entre chez vous avec un souffle
sous la porte, n’allez-vous pas être effrayée ?
C’est pourquoi je vous dis : n’ayez pas peur, écoutez-moi, puisque déjà ce n’est presque plus moi qui parle, qui vous
appelle du fond d’une exténuation dont vous n’avez aucune idée, et n’ayant pour vous que ces mots qui sont ma dernière
enveloppe en train de se dissoudre.
Cependant c’est sans importance :
si je souffrais, si j’avais peur…
Mais non.
Je peux vous dire
qu’on a beaucoup exagéré le malheur d’être ici,
de l’autre côté du passage — lui pénible je vous assure,
et même juste après dans la honte de tant d’emphase,
quand c’est fini.
(Pourtant rien ne s’achève ;
on croit avoir tout l’oubli devant soi comme une promesse
enfin tenue, et puis) — je ne sais plus
ce que je vous disais.
Ah oui, si je souffrais, si j’avais peur, ou si je vous aimais
encore,
alors vous pourriez redouter ces mots qui vous recherchent, qui rôdent jour et nuit.
Et je perçois autour de moi qui n’occupe plus aucun espace,
qui n’ai ni autour ni dedans, ni haut ni bas, comme une caisse
de planches démantelées avec ses clous tordus qui brillent,
je perçois en effet de grands claquements de bouches vides
peut-être redoutables.
Peut-être.
En tout cas moi c’est juste
un peu d’étonnement qui tient encore ensemble ce que je fus:
que tout n’ait pas cessé d’un coup me semble étrange,
et qu’une ombre du temps s’allonge à travers le passage
comme une eau faiblement insistante que boit du sable, ici.
Ou si je vous
aimais encore ; si
tant soit peu j’avais autrefois poussé dans la chaleur de votre corps quelques racines ; si
j’avais pu acquérir le savoir qu’enseigne la limite de l’autre
illimité soudain dans son amalgame de glandes ; si
j’avais fait mon creux dans la réalité organique de votre cœur
où le sang pompé noir jaillit avec l’allégresse du pourpre—
ainsi quelques instants roulé sous la rutilante fontaine,
il me resterait, je le crois, de votre humidité, de votre poids, de vos ténèbres,
assez pour flotter moins sans appui ni couleur dans le délabrement progressif de cette fumée.
Pourtant déjà quand j’approchais l’odorante auréole,
explorant sans bouger l’atmosphère de foudre errante et
de givre subit qui nimbe tout corps désiré, déjà n’était-ce pas dans la lenteur irrespirable autour et loin
que je me tenais en silence, n’ayant pour vous toucher que des constellations de
paroles, des girations de mondes barricadés par la distance et qui sur l’œuf en noir cristal massif où se résorbe leur
désastre ne sont plus que l’effleurement bref et musical d’une
touffe de plumes ?
Mais en ce temps autour et loin veillait la solitude.
Alors entre vous et l’espace étouffant qui m’a pris dans sa
glace, par la rue en dérive à longueur de nuit sur les confins le cœur enfin muet dans la profondeur insensible ayant cessé d’attendre et de vouloir pouvait descendre et
s’enfoncer toujours plus loin de la chaleur du centre :
quelqu’un veillait fidèlement de distance en distance, une main faisait signe peut-être à la fenêtre qui s’allume, s’éteint, se rallume la même un peu plus loin
comme cette ombre au coin toujours prête à surgir qui se dérobe — ombre,
passante, rien contre la nuit et le silence
qu’un nom, sous le vôtre affaibli, pour éclairer et retentir plus haut que le haut four à ciel à
Bologne des basiliques ou les toits du
Hradschin couvrant les combles obscurcis de la maison déserte où je vous poursuivais, l’Europe.
Et ce nom je pouvais l’épeler comme on insiste au
téléphone quand personne ne répond plus que le
Séparé, l’Obscur, le
Lourd, l’Inerte, le
Tué, le
Doux qui s’abandonne et se clôt froidement dans
l’espace de la muette — je disais solitude.
À présent plus d’autour puisque le centre a disparu, plus de lointain pour l’étendue nouée en travers de ma
gorge ; et son petit cœur chaud, la solitude, il a claqué sans qu’elle ait eu le temps d’éteindre la lampe et le
poste ; à présent je comprends qu’elle était morte — qu’elle est
morte.
II
Écoutez-moi pourtant :
quelqu’un doucement en chemin vers le plus-personne dit
je laisse tomber laisse peser laisse flotter mourir la pluie petite les montagnes les arbres les nuages ; où ici là partout quelqu’un a marché attendu tirant un fil invisible du
vide en mouvement de sa présence ;
Il poussait des portes, il se
foutait dans l’entrée en jurant contre la même armoire et pleurait dans son lit aux approches de quarante ans pour des choses de
Dieu, d’enfance ; avait un membre une âme un cœur de vrai polochon dans vos
bras théoriques de sœur comme un hôtel où la mémoire frappe de nuit ayant perdu presque tous ses bagages aux détours du grand collecteur qui nous avait
poussés de
ventre en ventre
et alors propulsés pourquoi vers ce confluent de gestes bloqués
d’adultère ou d’inceste, pourquoi
ce long cheminement par l’obscurité des matrices,
si c’était pour finir, au mur, sanglotant comme un con, laissant
les œufs glisser sur le carrelage de la cuisine,
par comprendre en voyant le ciel limer ses ongles sur les toits,
l’affreux soleil propager sa limite,
que la roue avait bien heurté la borne ultime du parcours
et n’avait plus qu’à valser dans le détraquement de la vitesse acquise ?
D est possible
que je vous cherche encore sans désir,
comme si quelque formalité là-bas n’avait jamais été
remplie ; possible
que là-bas je vous aie cherchée comme dans un couloir où l’on espère simplement l’autorisation de poursuivre le voyage au-delà par ces complications d’aéroports et
de
valises, et qu’ici vous, ce que je nommais vous en grand tremblement de tout
l’être, soyez ce plus rien vaporeux à neuf mille mètres d’altitude qui est le ciel inexprimé de tout désir.
Je me disais : que je meure, alors je serai la nourriture insubstantielle
de ses lèvres,
quelque chose de moi qui peine entrera dans la courbe de son nez
et plus profond même peut-être ; je priais :
prenez-moi dans la lunaison du sang, dans les pensées
qui passent de biais par éclats sous un crâne de femme, et dans
le linge au besoin prenez-moi, que baigne la chaleur de gloire.
Mais voilà
qu’ici je me contenterais d’une amitié de pierre
ou de la matérialité du vent qui chasse une lessive.
C’est triste.
Et non plus pas
très triste.
C’est.
Ou plutôt ça n’est guère.
Je voudrais me cogner à la fonte d’une chaudière et dire brûlez-moi,
m’égarer sous des murs de suie en ruines sans rien dire — égarez-moi — si l’on brûlait, si l’égareuse
pouvait enfin toucher mes poignets dressés dans la glace, mes genoux déboîtés par l’inutilité de la vitesse ou mes yeux devenus le dehors invisible de leurs
paupières.
Et encore je me disais que mort du moins glissant avec les caniveaux d’eau
pure, le granit des trottoirs, la lune aveugle sur les toits ; que mort sombrant avec la pente interminable de la rue où vous iriez à votre tour la nuit sans moi, perdue entre les
murs et les couloirs quand tout l’obscur remue et remonte pour respirer timide à la surface — au moindre signe réchappé de la profondeur décisive (une porte qui bat,
la lampe orange qui s’allume)
vous souririez songeant c’est lui comme autrefois qui m’appelle et qui m’accompagne.
J’ai disparu.
Non seulement de la surface où flotte et sombre vite
comme un sourire, mais de la profondeur de paix dans les pierres j’ai
disparu.
Ainsi l’eau quand se brisent le fond et les parois, le cœur, quand son noyau sous l’absence d’amour éclate, où le vide partout fait pente et perte se précipite —
écoutez-moi
parler encore un peu le cœur répandu dans ce vide qui gonfle comme un sac, se ferme comme un sac — au
sac les derniers débris de la voix, du cœur qu’on évacue.
III
On m’appelle.
On me tire.
Adieu.
N’écoutez plus.
Ma voix
comme un soir de vent radouci glisse vague mobile
et sans force de sable en travers de la route, sous la
canonnade liquide et l’herbe dans la bouche tremblante
de la pluie, et personne n’appelle et rien ne tire où s’accomplit le dernier tour du fil de la
bobine, et le vent radouci
comme un soir en travers ma voix dans la bouche liquide et sans force tremblant la canonnade de la pluie appelle et tire, et personne n’appelle et rien ne tire
adieu
jetez
la bobine quand tout le fil
aura cassé net sous les dents de la fileuse qui défile
et retrame le fil dans la voilure pour le souffle
en tous sens propulsant la masse du navire sans
écume ni rivage et presque sans
sans souffle mâts brisés pleins du crépitement tu
des signaux en arrière à rien — la soufflerie.
Adieu
n’écoutez plus.
On faisait autrefois des petites maisons pour que l’âme
des morts s’abrite en attendant la fin de la bobine,
des barques par l’extrémité du fil qui vibre encore
un peu vers la harpe du jour tirées
tirées entre les berges
les berges englouties
engloutis les roseaux et la face de l’estuaire
où flotte entre deux eaux comme au bout du film qui
s’achève un sourire pincé sur sa pauvre énigme.
Je sais, pour avoir si souvent dans les cabanes rituelles attendu près de vous la pluie étroite sur la toile, des moulins à prière autour suivant les derniers soubresauts du
son optique, je comprends maintenant que nous, vous et moi, nous des
autres je m’en doutais (mais pourquoi, mais comment, en quelle fausse profondeur d’écran perlé d’étoiles) n’aurons été là-bas que des doubles d’images
déjà
exténuées de copie en copie et disant vous, disant moi
ou si peu n’est-ce pas
mêlant ces lèvres d’émulsion sur une transparence inerte incombustible,
mais assez bien mimant le désir la douleur par bon cadrage, bonne lumière,
pour être au moins saisis du vertige de leur présence
ou d’un frisson de liberté dans l’emportement mécanique —
ainsi les personnages
des vieux films quelquefois protestent
comiquement
Je suis
sans conséquence,
et ces gestes ces cris bloqués vingt-quatre fois par virtuelle seconde,
à jamais pris dans la répétition nulle font signe aussi comme les astres,
supplient
du fond de l’impossible mort le temps
réel et déployé soyeux en nuages de les reprendre,
eux qui dans les ténèbres de cette lumière extérieure s’agitent,
se figent de nouveau hors des cercles de cercles où
toujours de nouveau comme en boucle au ralenti,
Dante reçoit le reçoit le premier salut de
Béatrice.
Disparu j’ai franchi.
Peu d’espace mais j’ai franchi
l’encerclement du révulsif
désir,
et la solitude à son tour je l’ai
franchie.
Ici
les images qui s’affaiblissent
cherchent l’œil sans foyer qui nous aura filmés dansant
sur la pente éternelle de la prairie avant
de nous projeter vous et moi dans l’épaisseur fictive.
Oh aidez-moi
à finir, aidez-moi,
que j’avance, que l’œil éclate et que je vous délivre
du temps lavé de moi comme une dalle où tremble encore votre image ;
que le ciel à portée de l’extrême impuissance de mes doigts
envahisse l’écran où vous demeurez prise — et paix,
paix comme avant que l’histoire n’ait commencé ;
crevaison, rebut du grand fond d’où sortirent nos souffles, nos visages ;
descente, déambulation dans la fin qui ne finit plus —
s’il vous plaît aidez-moi.
Attendez l’heure de la nuit
où l’œil juste avant l’aube un instant cligne et se renverse,
quand des pas, des voix, des ombres sans voix, sans pas, sans ombre glissent
par l’espace hors de l’espace enclos et déroulé —
alors n’ayez pas peur, écoutez-moi, glissez-vous, faites vite, mettez
simplement un peu d’air dans une boîte d’allumettes
et posez-la dans le courant
d’un ruisseau qui n’atteint la mer que noyé dans l’oubli,
dissous dans la force étrangère des fleuves,
et s’il vous plaît dites que c’est mon âme d’image qui vous aima
et qui morte s’égare entre les murs, contre l’oeil fixe, toujours plus loin de vous, de moi, de tout pour vous rejoindre.





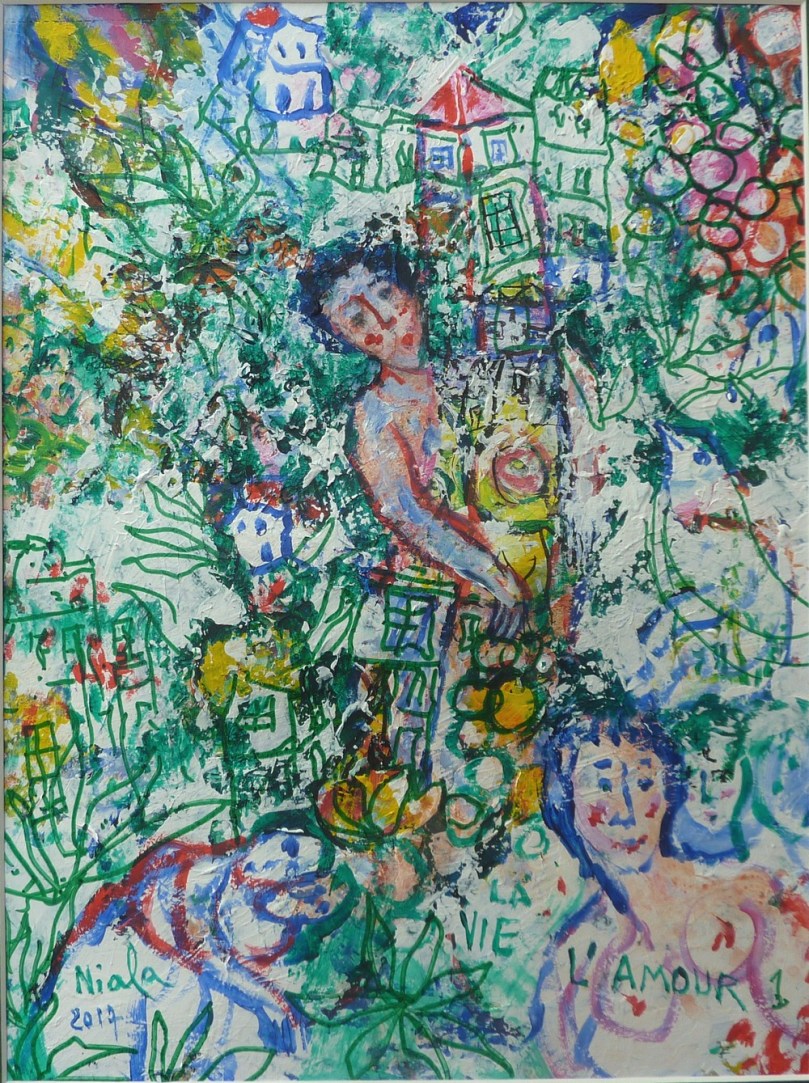


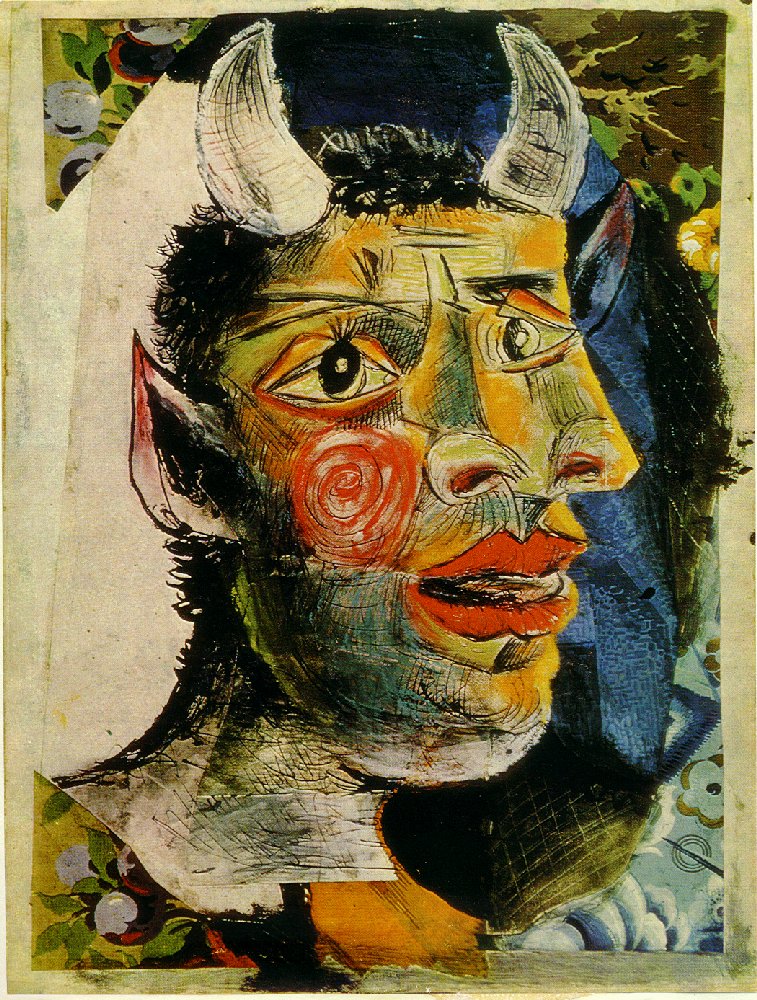


 Monstruosité du Présent
Monstruosité du Présent
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.