D’une tempe à l’autre
le sang de mon suicide virtuel
s’écoule
noir, vitriolant et silencieux
Comme si je m’étais réellement suicidé
les balles traversent jour et nuit mon cerveau
arrachant les racines du nerf optique, acoustique, tactile – ces limites –
et répandant par tout le crâne une odeur de poudre brûlée
de sang coagulé et de chaos
à mon propre déséquilibre
C’est avec une élégance particulière
que je porte sur mes épaules
cette tête de suicidé
qui promène d’un endroit à l’autre
un sourire infâme
empoisonnant
dans un rayon de plusieurs kilomètres
la respiration des êtres et des choses
Vu de l’extérieur
on dirait quelqu’un qui tombe
sous une rafale de mitraillette
Ma démarche incertaine rappelle celle du condamné à mort du rat des champs de l’oiseau blessé
Comme le funambule suspendu à son ombrelle
je m’accroche
Je connais par cœur ces chemins inconnus je peux les parcourir les yeux fermés
Mes mouvements
n’ont pas la grâce axiomatique
du poisson dans l’eau
du vautour et du tigre
ils paraissent désordonnés comme tout ce qu’on voit pour la première fois
Je suis obligé d’inventer une façon de me déplacer de respirer d’exister
dans un monde qui n’est ni eau ni air, ni terre, ni feu
comment savoir d’avance
Si l’on doit nager voler, marcher ou brûler
En inventant le cinquième élément le sixième
je suis obligé de réviser mes tics mes habitudes, mes certitudes
car vouloir passer d’une vie aquatique
à une vie terrestre
sans changer la destination
de son appareil respiratoire
c’est la mort
La quatrième dimension (5e, 6e, 7e, 8e, 9e) le cinquième élément (6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e) le troisième sexe (4e, 5e, 6e, 7e)
Je salue mon double, mon triple
Je me regarde dans le miroir
et je vois un visage couvert d’yeux
de bouches, d’oreilles, de chiffres
Sous la lune mon corps projette une ombre une pénombre un fossé un lac paisible une betterave
Je suis vraiment méconnaissable
J’embrasse une femme sur la bouche
sans qu’elle sache
si elle a été empoisonnée
enfermée mille ans dans une tour
ou si elle s’est endormie
la tête sur la table
Tout doit être réinventé il n’y a plus rien au monde
Même pas les choses
dont on ne peut pas se passer
dont il semble
que dépend notre existence
Même pas l’aimée cette suprême certitude
ni sa chevelure
ni son sang que nous répandons
avec tant de volupté
ni l’émotion que déclenche
son sourire énigmatique
chaque après-midi à 4 heures
(4 heures
ce chiffre préétabli suffirait à mettre en doute nos étreintes ultérieures)
tout
absolument toute initiative humaine
a ce caractère
réducteur et prémédité
du chiffre 4
même certaines rencontres fortuites les grandes amours, les grandes les subites crises de conscience
Je vois le sang crasseux de l’homme plein de montres, de registres d’amours toutes faites de complexes fatals de limites
Avec un dégoût que je finis par ignorer je me meus parmi ces figures toutes faites
connues à l’infini
hommes et femmes chiens, écoles et montagnes
peurs et joies médiocres révolues
Depuis quelques milliers d’années on propage
comme une épidémie obscurantiste l’homme axiomatique : Œdipe
l’homme du complexe de castration et du traumatisme natal
sur lequel s’appuient les amours
les professions
les cravates et les sacs à main
le progrès, les arts
les églises
Je déteste cet enfant naturel d’Œdipe je hais et refuse sa biologie fixe
Et si l’homme est ainsi parce qu’il naît
alors il ne me reste plus qu’à refuser
la naissance
je refuse tout axiome
même s’il a pour lui l’apparence
d’une certitude
A supporter comme une malédiction cette psychologie rudimentaire déterminée par la naissance nous ne découvrirons jamais la possibilité de paraître au monde hors
du traumatisme natal
L’humanité oedipienne mérite son sort
C’est parce que je ne me suis pas encore détaché du ventre maternel et de ses sublimes horizons que je parais ivre, somnolent et toujours ailleurs
C’est pour cela que mes gestes semblent interrompus, mes paroles sans suite mes mouvements trop lents ou trop rapides contradictoires, monstrueux, adorables
C’est pour cela que dans la rue rien, pas même le spectacle infamant d’un curé ou d’une statue ne m’irrite davantage que de croiser un enfant
Si je passe mon chemin
c’est que le tuer serait un geste
déjà fait et trop vague
Je préfère être parmi les gens comme un danger en suspens plutôt qu’un assassin
comme un provocateur de longue agonie
De cette position non-œdipienne
devant l’existence
je regarde d’un œil maléfique et noir
j’écoute d’une oreille non acoustique
je touche d’une main insensible
artificielle, inventée
la cuisse de cette femme
dont je ne retiens ni le parfum
ni le velours – ces attractions constantes
de son corps magnifique – mais l’étincelle
électrique, les étoiles filantes de son corps
allumées et éteintes une seule fois
au cours de l’éternité
le fluide et le magnétisme de cette cuisse
ses radiations cosmiques, la lumière
et l’obscurité intérieures, la vague de sang
qui la traverse, sa position unique
dans l’espace et le temps
qui se révèle à moi sous la loupe
monstrueuse de mon cerveau
de mon cœur et de mon souffle
inhumaine
Je n’arrive pas à comprendre
le charme de la vie
en dehors de ces révélations uniques
de chaque instant
Si la femme que nous aimons ne s’invente pas sous nos yeux
si nos yeux n’abandonnent pas
les vieux clichés
de l’image sur la rétine
s’ils ne se laissent pas exorbiter se surprendre et attirer vers une région jamais vue
la vie me semble une fixation arbitraire à un moment de notre enfance ou de l’enfance de l’humanité
une façon de mimer
la vie de quelqu’un d’autre
En effet, la vie devient une scène
où l’on interprète
Roméo,
Caïn,
César et quelques autres figures macabres
Habités par ces cadavres
nous parcourons comme des cercueils
le chemin qui relie
la naissance à la mort
et il n’est pas étonnant
de voir surgir
du cerveau abject de l’homme
l’image de la vie après la mort
cette répétition, ce déjà vu
cette odieuse exaltation du familier
et de la contre-révolution
Je hume la chevelure de l’aimée et tout se réinvente
Humer la chevelure de l’aimée
avec l’idée subconsciente et dégradante
de l’embrasser ensuite sur la bouche
de passer des préliminaires à la possession
de la possession à l’état de détente et de celui-ci à une nouvelle excitation résume toute la technique limitative de ce cliché congénital qu’est l’existence
de l’homme
Si en exécutant cet acte simple : humer la chevelure de l’aimée on ne risque pas sa vie on n’engage pas le destin du dernier atome de son sang et de l’astre le plus lointain
si dans ce fragment de seconde
où l’on exécute n’importe quoi
sur le corps de l’aimée
ne se résolvent pas dans leur totalité
nos interrogations, nos inquiétudes
et nos aspirations les plus contradictoires
alors l’amour est en effet ainsi que le disent les porcs une opération digestive de propagation de l’espèce
Pour moi, les yeux de l’aimée sont tout aussi graves et voilés que n’importe quel astre et c’est en années-lumière qu’on devrait mesurer les radiations de son regard
On dirait que la relation de causalité
entre les marées
et les phases de la lune
est moins étrange
que cet échange de regards (d’éclairs)
où se donnent rendez-vous
comme dans un bain cosmique
mon destin
et celui de l’univers tout entier
Si j’avance ma main vers le sein de l’aimée je ne suis pas étonné de le voir soudain couvert de fleurs
ou que tout à coup il fasse nuit
et qu’on m’apporte une lettre cachetée sous mille enveloppes
Dans ces régions inexplorées que nous offrent continuellement l’aimée
l’aimée, le miroir, le rideau la chaise
j’efface avec volupté
l’œil qui a déjà vu
les lèvres qui ont déjà embrassé
et le cerveau qui a déjà pensé
telles des allumettes
qui ne servent qu’une seule fois
Tout doit être réinventé
Devant le corps de l’aimée
couvert de cicatrices
seule une pensée œdipienne
est tentée de l’enfermer
dans une formule sado-masochiste
seule une pensée déjà pensée se contente d’une étiquette d’une statistique
J’aime certains couteaux
sur lesquels l’emblème du fabricant
ressuscite dans l’humour
les vieilles inscriptions médiévales
J’aime promener un couteau sur le corps de l’aimée certains après-midi trop chauds où j’ai l’air plus doux inoffensif et tendre
Son corps tressaille soudain comme il le fait toujours lorsqu’il me reçoit entre ses lèvres comme dans une larme
Comme si j’avais laissé traîner
ma main dans l’eau
pendant une promenade en barque
sa peau s’ouvre de chaque côté du couteau
laissant glisser dans sa chair cette promenade onirique de sang que j’embrasse sur la bouche
Je vois d’ici
le cerveau satisfait de l’homme qui me dénonce à la psychologie comme vampire
Je vois d’ici dans d’autres après-midi
quand mon amour est une flamme
égarée dans sa propre obscurité
poursuivi par sa propre inquiétude
se lançant à lui-même des pièges souples
et déroutants, des questions
et des réponses simultanées
de longs corridors
des escaliers tournant à l’infini
des chambres murées dans lesquelles
je me suis tant de fois suicidé
une végétation sauvage, un fleuve
je vois d’ici les circonvolutions
simplificatrices, orgueilleuses
et cyniques
qui découvrent en moi un narcisse encore un narcisse, encore un fétichiste un scatophage ou nécrophile ou somnambule ou sadique, encore un sadique
Avec une volupté secrète et inégalable qui rappelle l’existence travestie du conspirateur et du magicien
je prends la liberté de torturer l’aimée de meurtrir ses chairs et de la tuer sans être sadique
Je suis sadique exactement dans la mesure où l’on peut dire : il l’a tuée parce qu’il avait un couteau sur lui
J’ai sur moi une psychologie sadique
qui peut me surprendre
en train de violenter une femme
mais à cet acte
auquel participe tout mon être
ne participent pas
toutes les virtualités de mon être
Aucun acte ne peut dire son dernier mot mais dans n’importe lequel même dans l’acte le plus élémentaire je risque ma vie
J’aime cette paisible soirée d’été où je regarde par la fenêtre le firmament
Alors que mes yeux se laissent attirer
par une seule étoile
(j’ignore pourquoi je la fixe
avec tant de fidélité)
mes mains fébriles, minces, déroutantes
de vraies mains d’assassin
pèlent une pomme
comme si elles écorchaient une femme
Le sexe en érection
une sueur froide sur tout le corps
respirant de plus en plus vite
je mords le fruit
tout en regardant par la fenêtre
l’astre lointain
avec une candeur de démon
Je ne sais pas pourquoi
je pense maintenant aux deux sadiques
de la végétation
Guillaume
Tell et
Newton
mais si la loi de la gravitation
peut être déduite de la pomme légendaire
de
Newton et l’accélération des mobiles
de la flèche de
Tell
alors mon amour peut être lui aussi
qualifié de sadique
comme toute simplification
mythique et légendaire
J’aime cette aimée inventée cette projection paradisiaque de mon cerveau infernal dont je nourris mon démon
Je projette à l’infini sur sa chair angélique les convulsions, les poisons la colère
niais surtout ma grande
ma terrible passion pour le sacrilège
Cette passion illimitée pour le sacrilège
maintient à la température de la négation
à la température
de la négation de la négation
toute ma haine sans bornes
Ipour absolument tout ce qui existe parce que tout ce qui existe contient dans ses virtualités souterraines un tombeau que nous devons profaner et parce que nous-mêmes à cet
instant
avons la tendance cadavérique de nous accepter de nous axiomatiser
J’aime cette femme qui de ses veines
si précieuses
me prépare tous les matins
un bain chaud de sang
Après cette toilette élémentaire
de mon démon
je ne reconnais plus rien
même pas mon propre sang
Ghérasim Luca




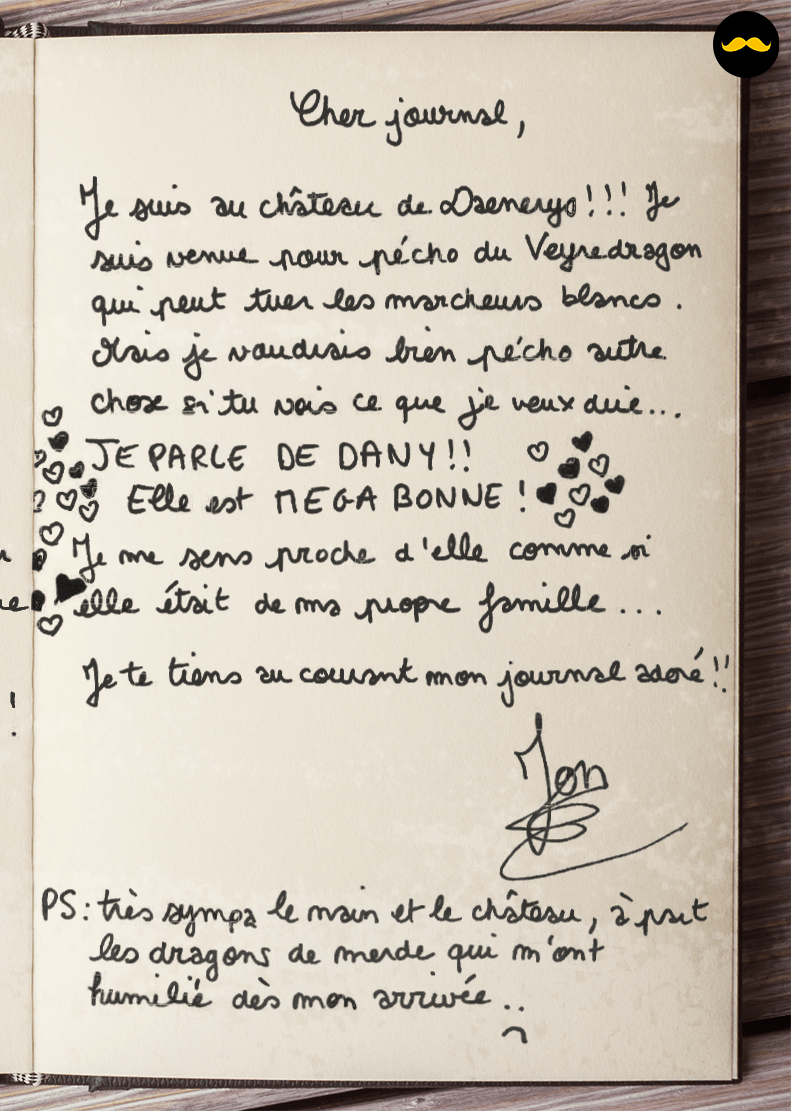


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.