
LA TOURNE – JACQUES REDA
— après cela (je commence, je commence toujours, mais c’est aussi toujours une suite), après cela j’avais essayé de quitter ma vie. Elle s’était en réalité
déjà séparée de moi, comme une maison rejette ses habitants à l’occasion d’un tremblement de terre. Bien sûr aucune maison ni cette vie ne m’avaient appartenu.
Cependant je restais pris sous les décombres. Il y avait dans cet écrasement encore de la protection et de la chaleur. J’aurais dû me tenir tranquille. Des événements
plus sourds se préparaient dehors. Insensiblement le temps s’était remis en marche dans sa poussière. Moi j’imaginais sans bouger un grand bond par-dessus ce désastre, ma
disparition d’un seul coup sur les rails où fonce une seule étoile déchiquetée. Mais tout s’accomplit à son heure, on décide peu. De nouveau j’entrepris des petits
voyages. Humbles, oui, et parfois de trois quatre kilomètres aux alentours (tous ces hérissons qui séchaient sur le bord de la route, transformés en galettes), puis d’autres
plus considérables mais guère différents pour le fond, renouant prudemment avec mon vieil espoir de le trouver à l’arrivée, l’autre aussitôt reconnu et qui
après un signe de connivence imperceptible (mais vu, compris), s’éloigne et je le suis jusque dans le couloir d’une sordide baraque à un étage où il faut faire vite :
un pas lourd au plafond ébranle des planches, précipite du plâtre, mais j’ai le temps d’apercevoir un vitrail de sureaux qui flambe sur les gravats. Alors il chuchote : C’est
vous ? — C’est moi.
Et nous échangeons ces pronoms comme des passeports volés à l’ambassade, avec les vrais tampons et le bleu brumeux de l’avenir dans chaque page, intact. Puis : les dernières
recommandations, les derniers vœux, l’accolade virile avant de nous perdre, chacun de son côté, dans la végétation déjà ténébreuse des rues. Jamais
rien de ce genre évidemment ne se produisait. Je tombais trop tard ou trop tôt dans d’immenses villes abandonnées. En général trop tard, par l’omnibus dont les
étapes à travers les banlieues divisaient à n’en plus finir la moitié de la moitié d’une distance obstruée par la nuit. Souvent, inexplicablement ou peut-être
à titre d’épreuve, on restait bloqué sur un pont, juste entre la rambarde et le souffle plein d’arrachements d’étincelles violettes des convois de sens inverse qui
cherchaient à nous culbuter, et je ne distinguais plus en bas qu’un remous pauvre aspirant le regard et l’espace avec l’eau du fleuve elle-même au fond du gouffre. Et j’avais peur, un
peu. Mais ne possédant pas de montre j’étais patient, surtout quand au lieu de la lune tirée comme un boulet incandescent par un silo ou une cheminée, luisait comme pour
soi, pour la pluie, l’écheveau des triages qui dans la plus compacte obscurité réfléchissent des bolides en proie sous l’horizon au silence dévastateur de leur vitesse.
Très loin brillait l’angle d’un mur.
Et contre, pour obéir à l’attraction du centre, dans un halo de ces becs de gaz les avenues encore indécises viraient en se prononçant pour l’équilibre, et rameutaient
ce troupeau de l’étendue bâtie vers son foyer. Mais un centre, à vrai dire (ce que moi j’appelais centre depuis qu’on m’avait expulsé du mien), les villes en ont un
rarement. Ou du moins elles le cachent, à la longue elles l’oublient, elles l’ont perdu ; et comment le découvrir sinon par hasard ou par chance ; et si ce que l’on trouve alors n’est
pas un simulacre, on le devine à la trouble douceur de déconvenue où s’étouffe le pressentiment : c’est un simple fragment qu’il faudrait combiner à d’autres (ces
pavés dans une arrière-cour, ces yeux qu’on a croisés et qui semblaient savoir, d’une science aussi ancienne et obtuse que celle des choses), pour obtenir enfin du désordre
apparent qu’on a remué de rue en rue la figure occulte et logique dont les lignes innombrables se recoupent en un seul point. J’explorais des périphéries.
Alerté puis déçu, puis appelé de nouveau comme si un cataclysme n’avait laissé debout que les ruines d’une volonté pareille à une phrase encore claire dans le
mot-à-mot, mais qui faute d’un verbe rétroactif maîtrisant l’émiettement du sens demeure intraduisible, ainsi je comprenais tour à tour la courbe en surplomb d’un
boulevard, du buis dans une impasse, la gaieté d’un sentier ; ailleurs un sous-sol sans maison rempli de cartons et de ferrailles, une façade sans immeuble, des moteurs au milieu d’un
pré ; ensuite un gros pneu dans un saule, deux enfants devant une affiche aux lions désabusés et, de chaque côté d’une usine éventrant par désœuvrement
ses carreaux au soleil puni, des maïs en papier jusqu’à de fulgurantes citernes. Et ensuite encore une rue, des maisons, plus de maisons, des jardins, plus de rue, plus personne, rien
que du ciel comme moi partout présent et partout égaré ; du ciel guettant le ciel sous des buissons, dans la profondeur des fenêtres ; du ciel dévalant au bas d’une
côte où vibrait le bord de l’horizon dans l’herbe comme un fil, puis sautant vers le ciel un instant fixe, vertical, avant de crouler avec la soudaineté d’une intuition nocturne
ou d’une bête. J’étais porté. Mais la loi qui le dirigeait renversait aussi bien le mouvement de cette fuite en spirale, et à certains indices (non, je n’avais jamais faim,
j’étais stimulé par la pluie), encore dans l’hésitation de la lumière qui gonfle sur les derniers chantiers, je savais qu’il me reconduisait vers l’intérieur, dans les
quartiers que la fin du jour saisit d’une puissante hébétude. Là des palais, des musées, des pelouses, des banques, des ministères délimitaient l’aire bientôt
déserte où je pensais que le centre en peine viendrait traîner peut-être avec la nuit. En tout cas je me reposais quand à force de marcher j’avais touché la pointe
anesthésique de la fatigue, et m’abandonnais sur un banc à l’inertie tournoyante de la planète et des corps des millions de dormeurs autour de moi qui veillais dans la cataracte
en suspens de tant de silence. Qu’est-ce que j’ai retenu? Sans grande passion pour l’histoire, observateur médiocre (ou je m’éprends une à une de toutes les briques d’un mur, ces
briques crues des temps qui tiennent juste au creux de la main avec le poids et l’or et la tiédeur d’un petit pain retournant par-delà des siècles à sa farine), seul et
sombre comme illettré dans les accords fondamentaux des musiques que font les langues, mais j’écoutais; confiant en d’absurdes systèmes établis sur les goûts des tabacs
(car une odeur autant qu’un lieu pouvait me livrer le centre — et les poches alors bourrées de dix variétés de cigarettes, les moins chères, celles qui sous de
naïfs emblèmes cosmopolites perpétuent la dérive de journées de chômage et de samedis de bals à tangos), je flottais avec ma fumée et n’en sortais que
comme une fine antenne promenée par la ville elle-même, une lanterne qu’elle portait en rêve au travers de sa propre masse pour en sonder l’énigme et l’épaisseur. Quant
au centre j’en parle, j’en parle, mais après coup. Je suivais une pente. Qu’elle m’ait aspiré jusqu’à lui, et je ne serais pas ici tranquillement à relever encore ses
traces, puisqu’il accordait cela du moins, traces ou signes par l’antenne aussitôt en éclair vers le cerveau pour y cristalliser la distraction en vigilance. Oui, tout cela prompt,
furtif, car si centre il y a, ce n’est rien que ravalement d’une indifférence féroce. Il m’aurait englouti. Par exemple je me souviens d’une porte : elle battait au fond d’un couloir
et j’ai vu beaucoup d’autres portes, mais c’était donc celle-là ; une autre fois, à Bologne, près d’une basilique en agglomérés de lune, un petit théâtre
d’ombre et de linge improvisait pour un buste d’Hermès aux yeux rongés, et c’était ce drame. Puis quand le soleil poussait du front sur les potagers aujourd’hui
défoncés en haut de Belleville; quand cette galerie qui obliquait encore à Prague entre des magasins se transformait en église et, pour finir, en square où des couples
muets déambulaient dans la chaleur, sous la lueur des globes exténuée d’avoir franchi les poussières du songe : c’était là, je ne bougerais plus, bien que ce ne
fût ni le but ni l’étape, mais cette déception en somme réconfortante d’avoir pour un moment trouvé l’enclos dont j’aurais pu, après tant d’heures usées
contre du vent, contre des pierres, devenir pierre et vent à mon tour le génie sans identité qui sous un ciel de glace, les rayons déclinants, allume entre l’inerte et les
yeux obscurcis une étincelle. Alors on connaît sans savoir. On connaît que des êtres passent, et que des événements s’infiltrent. Alors j’ai pénétré
des cœurs, entendu le déclic prémonitoire dans le retrait d’existences vouées à la désolation ou à la sauvagerie. Et de quel droit? Celui qui peut
connaître ainsi, malgré soi qui fracture, l’équité voudrait qu’il assiste ensuite : or lui s’en va. Je repartais, en effet, attiré de nouveau dans les faubourgs par
cette lampe qui de relais en relais au sommet des immeubles révèle et dérobe à la fois l’éclat du centre inaccessible. Et toujours cependant, à voix basse imitant
la mienne, quelqu’un me demandait d’attendre encore, encore un peu, mais il fallait que je m’en aille, amalgamant sans m’en douter quelque chose de ma substance à ces blocs d’inconnu.
Ensemble nous avons produit de l’angoisse et du danger, des lambeaux d’illusion qui puisent à mes dépens dans leur détresse de n’exister qu’à peine une sorte d’énergie.
Car en contrepartie la mienne s’amoindrissait. Et maintenant, comme moi j’avais erré à la recherche du centre, obsédées par l’oubli des mots qu’elles avaient voulu me dire,
que j’avais refusés (et qui étaient le passeport, peut-être, la formule de l’échange avec l’autre et notre délivrance), ces empreintes à moitié vivantes de
mon passage s’étaient mises à rôder. Comment faire pour les aider, et qu’elles me pardonnent ?
Souvent elles apparaissent, consternées au grand jour, sans arrêt, comme à coups de pelle, qui vient les déterrer, mais pour ne pas gêner, pour se donner l’air
hypocrite de tout le monde, elles vont manger une gaufre près de la consigne aux bagages, s’attarder sans motif dans les bazars où elles achètent n’importe quoi d’inutile pour
elles comme une lime à ongles et des savons, des savons. Elles ont honte, je sais, mais c’est ma honte qu’elles endurent, et la honte ou déjà la peur m’empêchaient de les
rejoindre quand j’étais sûr qu’elles m’avaient fait signe à cette façon de brandir là-bas la manche d’un manteau vide, au rideau qui bougeait derrière la vitre
d’un de ces vieux bistros confits dans les relents de la soupe et du pétrole. Je me méfiais. J’aimais mieux écrire des lettres et même les expédier, scrupuleusement
affranchies quoique sans adresse. Tant bien que mal essayant de me justifier. Mais ces explications me jetaient du haut en bas des pages comme dans des rues, et le virage automatique au bout de
la ligne m’abattait avec des pans de phrase entiers dans le brouillard. À cela aussi je renonçai. Puis il y eut une série d’incidents que je ne dois pas rapporter. Je n’osais
plus sortir ni décrocher le téléphone. Enfin, rassemblant mon courage avec ces objets modérés qui nous soutiennent quand nous lâche le reste — un seul livre,
la casquette, la brosse à dents — une fois de plus je résolus de partir. Où j’irais, peu importe. Mais là-bas tout recommencerait peut-être, et déjà
tout recommençait. Un train aux horaires fumeux montait vers la frontière, dans cette zone où les haltes en fin de journée se multiplient. La nuit aussi montait. Sous les
entablements obscurs, des rayons d’intelligence et d’amour touchaient le front des bêtes rencontrées. À chaque arrêt on voyait sourdre la lueur basse et puissante qui dort
au fond des murs. Les regards en étaient protégés par des visières, et les paupières des enfants qui ne cessaient de fumer sur les déblais restaient baissées.
Une averse, toujours devant, brassait dans l’odeur des lilas celle de la fumée et d’essences plus rares dont la vigueur, avec le cristal des appels, signifiait l’extrême altitude. La
gare où l’on s’attardait à présent était exactement semblable aux précédentes, peut-être plus foncée. Mais on avait monté encore, et rien
n’était changé dans l’intensité de camouflage de la lumière. Seule la pluie avait dû basculer vers des ravins ; un souffle par contrecoup achevait de s’épuiser en
gros tremblements de portes. Quelqu’un fit observer que les orages ne passaient jamais la frontière. D’autres phrases prononcées comme en rêvant flottèrent dans le wagon
— puis de nouveau le silence appuyé sur la vibration décroissante des vitres, les craquements des ressorts. Des sommets élevaient sur nous leur braise interminable.
Brusquement j’empoignai mon sac pour descendre, comme sans réfléchir. Le billet servirait plus tard, si je continuais ce voyage.
Personne, d’ailleurs, ne me le réclama. Les employés s’étaient tassés près du fourgon de tête, devant l’interruption du quai parmi des herbes dont luisaient les
tiges encore sensibles sous le vent. Ils formaient un groupe bien dense, bien noir, où de seconde en seconde un geste, qui semblait le dernier, éclatait saisissant comme le poing
plongé dans une eau trop limpide. Je les regardai longtemps. C’était une émeute immobile. J’allais comprendre quand la nuit tomba d’un seul coup. II y avait un hôtel en face
de la gare, juste au coin d’une rue qui allait se perdre vers des sapins. Du portier somnolent sur les pages de son registre, la voix ne me parvint qu’après avoir tâtonné dans
les chambres, cherchant celle où j’irais dormir. Mais j’avais le temps, tout le temps désormais plus lourd et plus stable que la montagne. Alors j’ai raccroché la clé
numéro 9 sur le tableau. J’escaladais maintenant cette rue qui décourage vite les maisons : au niveau des toits ce n’est plus qu’un sentier, après un coude abrupt
précipitant le village. La montagne allait devant moi, claire comme une pensée qui se sait condamnée et qui résiste. Au bord d’un ressaut étroit je me suis adossé
contre sa masse et, tout en bas, dans le train qui prenait la courbe vers la frontière, à trois reprises j’ai vu le compartiment que j’avais laissé vide s’éteindre, se
rallumer. J’ai dit doucement : bon voyage. Trois fois aussi le calme absolu de l’hôtel cette nuit m’a réveillé. Je sens le poids de la montagne. La lumière profonde a
disparu. Mais, sur la place, luit encore tout ce qui peut luire avec modestie et confiance : une étoile, l’anse d’un seau. Je recommence.
Jacques Réda








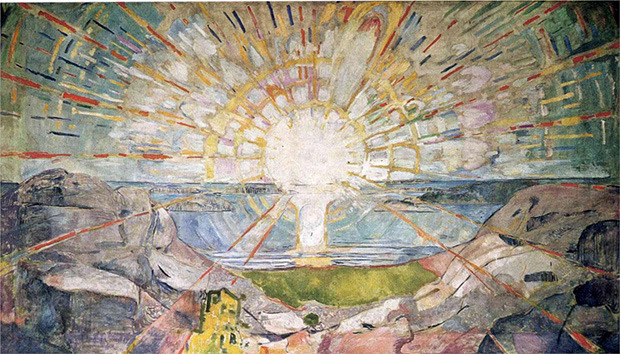








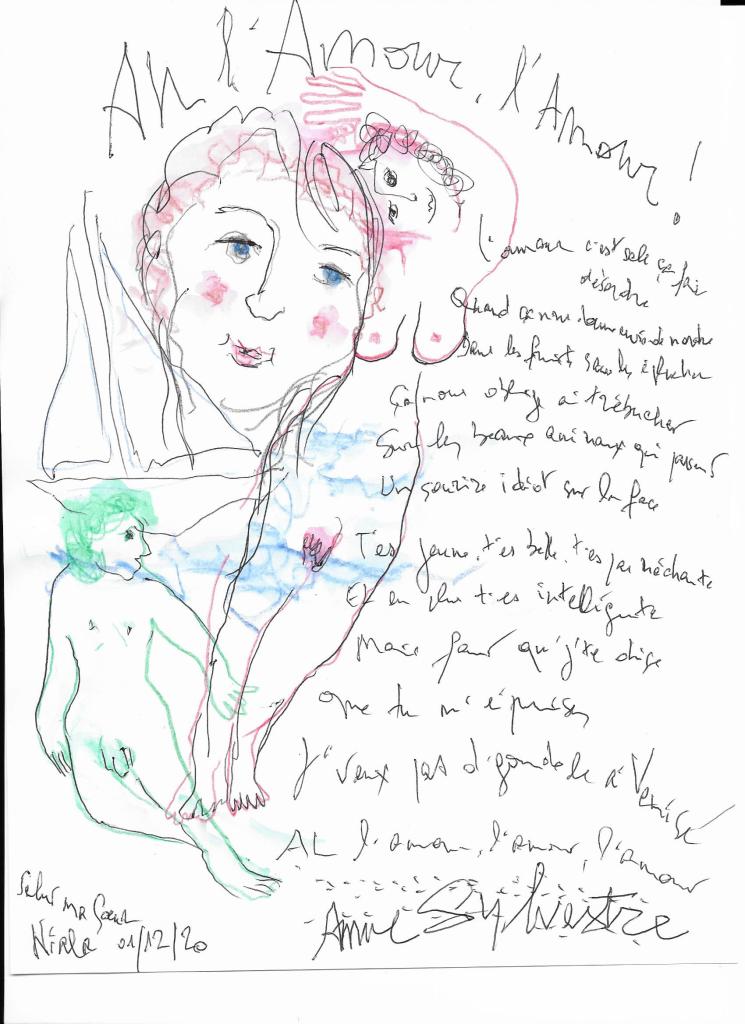
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.