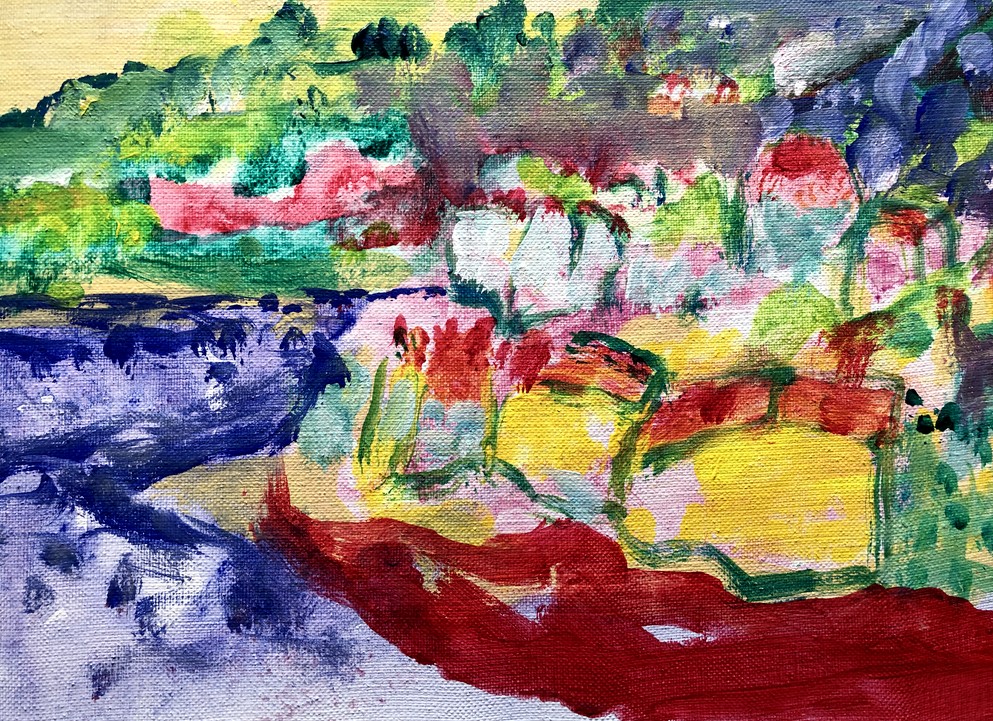
HISTOIRE DE L’ENTRETEMPS
En cet entretemps-là, celui de la légende et du mythe, l’écorce terrestre était en mouvement. Les derniers grands glaciers venaient de fondre, engloutissant leurs
mastodontes. Des volcans explosaient en chaîne, suscitant déluges, tremblements de terre, raz de marée dont parleraient plus tard tous les livres sacrés, du Popol Vuh à
la Genèse. L’écriture existant à peine, la légende précédait Y Histoire pour dire les combats terribles des géants contre les dieux, ceux-là mêmes
qui aideraient les hommes à bâtir leurs palais titanesques, leurs forts cyclopéens.
Atlas et Quetzalcoatl, frères jumeaux et barbus, soutenaient en commun le ciel sur chaque rive océane. Des forêts de Bretagne à celles d’Amérique les peuples adoraient
la pluie, la lune, le soleil, leur sacrifiant jeunes guerriers et vierges. Sur les parois des grottes, en Dordogne, en Espagne, les chasseurs dessinaient l’aurochs à transpercer. Lentement
prenait forme un monde terrorisé tandis qu’entre les continents resplendissait l’Atlantide aux dix rois, protégée de Neptune, avec ses vallées, ses lacs, ses rivières,
ses prairies couvertes de fleurs, ses légumes, ses fruits, ses forêts plantées de grands arbres, ses mines produisant orichal-que, étain, or; ses chantiers navals, ses
temples, ses statues, ses sources chaudes et froides qui ne tarissaient jamais, ses gymnases et son hippodrome.
Tel était ce pays dont la culture aurait ensemencé la terre entière et qui fut rayé de la carte en un jour et une nuit. Sous les mers, les sables, les glaces, gît
quelque part une Atlantide, berceau réel ou mythique de toutes nos civilisations. Mégalithes et cromlechs celtiques, pyramides aztèques et mayas, cités sacrées des
Incas, fresques du Haut-Atlas, géants de l’île de Pâques, palais de Crète et de Mycènes, ziggourats de Mésopotamie, temple de Zimbabwe sont peut-être
reliés par un fil mystérieux venu de cet âge d’or associé aux puissants Atlantes.
Nul n’a découvert l’Atlantide ; tous ont rêvé ce possible Éden où l’Homme délivré du temps aurait pu être Dieu.
Après avoir gravi avec moi les quatre degrés d’escaliers abrupts conduisant au sommet de la pyramide du Soleil, Ricardo, l’homme du Mexique, s’est immobilisé à l’aplomb
exact du centre de l’édifice. Très droit, les bras plaqués au corps, il a fermé les yeux un bref instant pour laisser monter en lui l’énergie cosmique accumulée
depuis des millénaires au cœur du sanctuaire: il renouait avec les dieux qui s’étaient sacrifiés par le feu sur cette esplanade entre terre et ciel afin que le soleil,
chaque matin, renaisse.
Quand nous redescendîmes il était midi. J’eus le sentiment que ce même soleil brillait d’un éclat plus vif, redonnant leurs couleurs aux têtes sculptées de
Quet-zalcoatl : gueule rouge, crocs blancs, plumes vertes. Sur les murs des maisons, les portiques des palais, sur la fresque des jaguars, réapparaissaient le bleu, l’ocre jaune et le
brun. Une fois encore le cinquième soleil de Teotihuacan triomphait des cendres nocturnes.
Ricardo, lui, savait que les quatre premiers étaient morts, balayés tour à tour par les grands carnassiers, les tempêtes de vent, les pluies de feu, les déluges. Il
savait qu’un tremblement de terre menaçait d’engloutir celui-là aussi, mais voulait croire au triomphe de l’énergie vitale sur les forces de destruction.
Quand nous reprîmes notre marche à travers la ville où les dieux furent créés, là où ils continuent de vivre dans l’harmonie des volcans, de la pluie, des
oiseaux de jade, je pus lire dans les yeux de mon ami — des yeux aux reflets d’obsidienne — une confiance nouvelle dont j’étais gagné à mon tour.
« Là-bas, me dit-il, dans les temples au bord de la mer, les Indiens parlent une langue que je ne comprends pas ; mais elle est si douce, si mélodieuse que l’espoir seul peut en
être la source ; l’espoir d’un avenir solaire que nulle mort ne saurait nourrir. »
Juché entre un ciel de glaciers et des abîmes de tropiques, Machu Picchu, le Vieux Pic, continue de flotter dans les nuages du temps. Fut-il forteresse contre les tribus d’Amazonie,
sanctuaire de l’Inca, lieu sacré des Vierges du Soleil? Tout à la fois peut-être ; nul n’a tranché.
Dans ses grottes, ses tombeaux, ses caches, quel peuple toujours le hante à l’état de momies caparaçonnées d’or, attendant le retour de l’astre-père? Si les toits se
sont effondrés — un rien les remettrait en place — le granité des murs n’a pas subi le moindre glissement après des siècles de séismes.
Le temple aux trois fenêtres en forme de trapèze d’où le regard se perd dans le bleuté des cordillères reste la caverne originelle qui engendra les fondateurs de la
dynastie. Sur son esplanade envahie d’herbe et dans ses jardins suspendus, plus audacieux, quand ils plongent dans F Urubamba, que ceux de Babylone, pousseront de nouveau le maïs, le coca
et les orchidées pour peu que les prêtres le veuillent.
Ces prêtres les voilà, au solstice d’été, qui montent en procession vers FIntihuatana, point culminant de la cité. Parvenu à la dernière plate-forme leur chef
entoure d’une chaîne en or la Pierre où l’on attache le soleil, empêchant celui-ci de s’enfuir au nord, ce qui condamnerait son peuple au froid mortel.
Suivront les réjouissances. La chicha coulera à flots tandis qu’ Achankaray, la plus belle des vierges solaires, distribuera l’herbe magique qui redonne vigueur et joie. Ainsi
rayonnait la ville aux trois mille marches quand le secret de son existence fut bvré par un Indien, pour quelques pièces, à l’explorateur américain Hiram Bing-ham. La vie
s’en retira d’un coup derrière le masque de la végétation.
Celui qui gravit les degrés de Machu Picchu rendus à la lumière ne visite qu’une apparence de ville à l’infinie patience. L’eau lustrale recommencera de couler dans les
fontaines, les orchidées de pousser sur les terrasses, le soleil d’indiquer sur le gnomon le moment de la récolte à l’instant même où l’intrus rejoindra le souvenir de
son inexistence.
Un autre lieu magique dans la légende de l’entre-temps est cette île de Pâques « qui est à la Polynésie, peut-être, ce qu’une Egypte encore enfouie dans le
limon original serait à une Grèce paresseuse et trop esclave de sa chair » (Elie Faure). Après une errance millénaire ils sont revenus dans leur île, seul vestige
du grand continent englouti.
D’abord ils furent sept, guides d’un peuple épars qui, génération après génération, avait rêvé le sanctuaire. Les autres suivirent sur leurs pirogues
à balanciers ou leurs radeaux de balsa. Ensemble ils réinventèrent dieux et ancêtres aux longues oreilles avant de les tailler dans le cratère du volcan. Telle est
l’origine de ces géants de pierre dont les Pascuans parsemèrent l’île et ses rivages.
Quand les sept guides eurent disparu, des effigies prirent leur place, visage face à l’océan qu’ils avaient su braver. Les autres statues représentant les sages après leur
mort tournaient le dos à la mer. Leurs yeux de corail blanc à la pupille de tuf rouge contemplaient, afin de l’assumer, une partie du monde dont l’île était le
nombril.
De chacune émanait la puissance, le flux vital qui donnait aux fidèles la force d’exister sur ce rocher d’exil. Dans du bois taillé en tablettes ils gravèrent leurs textes
sacrés que nul n’a déchiffrés. Des guerres de clans et l’arrivée de notre « civilisation » eurent vite raison des maîtres de l’île de Pâques.
Beaucoup de statues restèrent inachevées sur les flancs de la montagne ; la pluie et les embruns continuent d’en estomper le relief. Certaines s’écroulèrent ou furent
jetées bas. Dans les visages debout, les orbites profondes perdirent tout regard, comme si l’univers qu’elles avaient tenu en leur pouvoir s’était, lui aussi, vidé de sa
substance magique, réduisant leur rôle à néant.
Quand la brume, le soir, envahit Râpa Nui, elle masque une île semée d’aveugles figés dans un mystère sans objet.
Dans le Diwan-i-Khas, salle des audiences privées où le Grand Moghol trônait sur une colonne figurant le centre du monde, les enfants du village proche jouent aux osselets. Avec
les perroquets accrochés aux ciselures des corniches, les colombes roucoulant aux bords de bassins glauques et les petits lézards traversés de lumière, ces jeunes
garçons restent les seuls vivants de cette cité fantôme juchée sur une colline au nord de l’Inde: Fatehphur Sikrî.
Esplanades sans promeneurs, galeries sans courtisans, harems sans odalisques, caravansérails sans marchands, écuries sans éléphants, porches sans soldats, palais vides: tel
est le visage déserté de l’ancienne capitale d’Akbar. Née d’un désir de fertilité — il fallait un fils au descendant de Gengis Khan — Fatehpur Sikrî
fut délaissée quinze ans plus tard, quand l’eau cessa de couler; c’était il y a quatre siècles.
L’orgueilleuse ville de grès rouge et de marbre blanc ne retrouva jamais la vie, comme si la naissance enfin venue d’un prince héritier avait, par un effet contraire, condamné
son image à mort. Sur la porte de la mosquée, on peut lire cette inscription prémonitoire : « Le monde est un pont: passe sur lui mais n’y construis pas de maison. Qui
espère pendant une heure espère pour l’éternité. Le monde est une heure: passe-la en prière car ce qui suit est inconnu. »
Le crépuscule jette son ocre sur les clochetons et les dômes. Les enfants sont rentrés au village où le muezzin appelle aux dévotions du soir. Pour un festin, surtout
de pierre, l’heure des chacals approche.
Houmayoun, fils de Bâbour, lui-même descendant de Tamerlan et de Gengis Khan, fut ce guerrier terrible que mille éléphants de bataille et cinquante mille ennemis ne
pouvaient effrayer. Il sut reconstituer F Empire mog-hol des Indes et reconquérir un trône dont l’avait évincé le sultan Sher Shah. La guerre éteinte, ce prince
redevenait une homme de culture ; Houmayoun aimait surtout les livres.
Un an à peine après sa victoire, il faisait une chute mortelle dans l’escalier de sa bibliothèque, montrant par là que le calme des cabinets de lecture peut être plus
néfaste à un soldat que le fracas des champs de bataille. Sa veuve lui fit élever un admirable mausolée de marbre blanc et de grès rouge qui allait servir de
modèle aux tombeaux moghols à venir. La fin ridicule de ce fier souverain transforma en œuvres d’art d’autres morts qui, sans lui, eussent été banales.
Les Jardins de Lodi appartiennent aux frêles écureuils gris, aux corneilles, aux perroquets verts à la queue turquoise qui volètent gracieusement sur les ruines en
arabesques de la cité moghole. Lente errance hors du temps des bœufs à bosse, buffles, vaches privées de chair.
Allongés sur des sommiers en bois et cordes posés à même la poussière du chemin, des hommes lisent le journal. Autour d’eux le pépiement des enfants presque nus,
la présence des femmes qui savent se draper dignement de misère. Quand vient le soir on allume des braseros afin de mieux franchir la fraîcheur de la nuit.
Un dimanche pauvre et paisible à Delhi, capitale de l’Inde.
Mausolée du Tadj Mahall ou la mémoire blanche et lisse d’une mort non acceptée. Un Grand Moghol éprouvait tant d’amour pour son épouse légitime qu’à sa
disparition il éleva en souvenir d’elle ce tombeau.
Henri Michaux s’en moque avec humour: « Réunissez la matière apparente de la mie de pain blanc, du lait, de la poudre de talc et de l’eau, mélangez et faites de cela un
excessif mausolée. » Il est vrai que la perfection du marbre immaculé qui s’enfle en coupoles bulbeuses, s’élance en minarets, se creuse en niches marquetées avant de
s’étirer en pures esplanades, agace en émerveillant. Pièce montée de sucre candi peut-être, mais ô combien réussie!
Au-delà du monumental portique marquant l’entrée dans l’enceinte, s’ouvre la perspective, vers le mausolée, de miroirs d’eau en plans successifs que des jardins encadrent.
Soudain la gêne disparaît, à peine le regard a-t-il glissé jusqu’aux reflets des bassins : voici un autre Tadj Mahall en image inversée dont le marbre et les contours
frissonnent. L’âme de la princesse a déserté la nef pour mieux nous sourire aux margelles.
Au cœur de la Cité du Paradis à Sikandra, Akbar le Magnifique repose à la croisée de quatre jardins sous un mausolée en pyramide à cinq étages
coiffé d’un cénotaphe, l’esplanade du dernier étage ayant pour seule coupole un ciel toujours pur.
La tombe proprement dite, correspondant au cénotaphe, est enfouie dans les profondeurs de l’édifice, marquant l’opposition entre le corps promis aux ténèbres et l’âme
en quête d’illumination.
Celui qui entre à l’aube dans ces jardins, par un des quatre portails monumentaux marquetés de grès rouge et de marbre blanc, découvre les parterres de fleurs, les pelouses,
les fontaines, les arbres toujours verts. En leur feuillage vit un peuple de singes dont les jeux, les cabrioles, les mimiques, les cris joyeux ou agacés brisent à l’instant le
silence et l’austère majesté des lieux. Ne dirait-on pas que l’esprit du Grand Moghol, ayant compris la vanité de toutes choses, a décidé de rester présent au
visiteur sous l’enveloppe virevoltante de ces petits singes à l’âme si ténue mais à la vivacité si grande que nulle éternité ni pourrait les dissoudre en un
banal et frêle souvenir.
A Jaïpur sur une esplanade du palais, ces arcs semi-circulaires, hémisphères creux, triangles, cercles dont le marbre et le grès scintillent sous le soleil ne sont pas des
sculptures abstraites mais les appareils de visée d’un observatoire astronomique, agrandis cent fois d’après l’instrument manuel. L’observatoire fut édifié au XVIIIe
siècle par un maharadjah qui voulait prendre la mesure exacte du ciel. Avec des appareils de visée à cette échelle il pensait gagner en précision sur ses calculs
stellaires.
Sa tentative échoua: son rêve d’espace demeure. Astrolabes, sextants, gnomons, théodolites continuent, seuls, d’observer le ciel. Par les claires nuits du Rajas-than ces
constructions futuristes inventent un étonnant tracé d’ombres, images renversées d’une voûte céleste qui semble préférer, aux chiffres du cosmos, le
mystère lumineux des formes bleues sur les terrasses.
Calcutta. Une aire close de murs au bord de la rivière où les morts drapés de blanc et couverts de fleurs sont apportés sur des litières tenues haut par quatre hommes
qui fendent la foule d’un bon pas. Dans le sol en terre battue un trou est creusé aux dimensions d’un cercueil puis garni d’un lit de petites bûches sur lequel le cadavre est
étendu, son visage oint d’une huile sacrée, avant d’être recouvert de grosses branches. Parfois la tête et les pieds dépassent — le bois coûte cher et doit
être économisé. Ici on brûle des pauvres. Le responsable du bûcher y met le feu et, pendant plusieurs heures, le bas du visage couvert d’un mouchoir humide pour se
protéger de la fumée acre, il veillera à la bonne combustion de l’ensemble, réorganisant le brasier, rassemblant les morceaux du corps qui ont échappé à la
flamme, tels ces deux pieds encore intacts à l’extrémité de tibias calcinés.
La famille du disparu sera présente le temps de la crémation, visages apaisés, sereins; aucune tristesse apparente. Dans l’intervalle, des porteurs continuent d’arriver avec
d’autres corps ; de nouveaux trous seront creusés; le cérémonial recommence.
En leur incessant va-et-vient, mort et vie mêlent soleil et cendres.
Le pont de Howrah est une imposante arche métallique qui enjambe un affluent du Gange et relie la ville à son faubourg industriel. Chaque jour, un million de personnes le traversent,
traduisant l’activité laborieuse de cette métropole d’Asie. Par un puissant contraste, sous ce pont même, au bord du fleuve, l’Inde éternelle continue d’exister selon
l’antique tradition: hommes, femmes, enfants viennent se plonger dans l’eau fétide, moins pour être propres que pour être purs. Adeptes de Vishnou, de Shiva, sacrifient à
leurs dieux devant ces petits temples rustiques dressés sous les figuiers, à l’abri des poutrelles géantes. L’atmosphère est paisible ; les temples évoquent des
guinguettes où une communauté a trouvé refuge: vieillards en méditation, masseurs, marchands, sadhus (mendiants itinérants couverts de cendres), acrobates,
lutteurs.
Dans le grondement des véhicules qu’amplifie le tablier du pont, la vie pareille au fleuve coule et oublie le temps.
De l’autre côté de Howrah Bridge, il y a la gare de Calcutta dont Michaux, encore, écrit : « Entre toutes les gares du monde, la gare de Calcutta est prodigieuse. Elle les
écrase toutes. Elle seule est une gare. » S’il est vrai qu’une gare est un endroit où des gens attendent des trains, aucune autre en effet, parmi celles que je connais, ne peut
lui être comparée. Ils sont là des centaines, des milliers peut-être, sous les ventilateurs, assis ou couchés à même le sol vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, agglutinés autour de leur maigre bagage, qui attendent des trains dont on se demande s’ils arriveront jamais. Cette foule silencieuse et résignée, pour laquelle la
notion d’horaire est du domaine du songe, ignore qu’un temps humain existe. Après quelques-unes de nos minutes passées à les regarder, l’idée d’entretemps s’impose comme une
évidence, naturelle pour eux, difficile à concevoir pour la plupart d’entre nous.
Les orgueilleuses mansions construites par les Anglais au tournant de ce siècle sont devenues caravansérails croulant sous la crasse, dont les façades écaillées
dominent la paille rase d’anciens gazons. Dans les altiers vestibules halètent des ascenseurs en fer noir, cages de tortures prêtes à rendre l’âme entre deux étages.
Portes et parquets craquent à tout instant, peuplés de fantômes victoriens.
Hôpitaux du souvenir, ces grands immeubles se délitent, emportés pièce à pièce par la terrible et tourbillonnante vie de Calcutta, dans la chaleur humide, la
poussière. Pour les remplacer, d’un côté le verre, le béton, l’acier; de l’autre le torchis, la ferraille, les planches… ou rien; rien qu’un lambeau sans couleur tendu
entre deux piquets : la « maison » de cet homme, de cette ombre accroupie sur le trottoir et qui, pour une roupie, frappe de son moignon les cuisses des passants trop pressés qui
l’enjambent.
A Mahabalipuram, non loin de Madras, sept chars de procession sont alignés près du rivage selon le plan sacré du mandala. Oratoires mobiles, ils seront tirés par des
éléphants jusqu’au sanctuaire de la grotte du Tigre afin d’y honorer les dieux.
A gauche du char de tête, le taureau Nandi, monture de Shiva, est couché sur le sable. A droite, un des éléphants, debout, attend d’être attelé.
Sous un ciel très bleu mouchetée de palmiers, la grande fête des Pallavas est prête à commencer…
… Treize siècles plus tard, tout est en place au même endroit. La scène semble avoir été pétrifiée. Les chars, le taureau, l’éléphant, s’ils
n’étaient de granité, pourraient se mettre en mouvement… et dans le regard des enfants qui virevoltent alentour, comment ne pas lire cet espoir vague qu’une fête, même
noyée dans la pierre, a quelque chance, un jour, de resurgir.
Par la pluie diluvienne des moussons, par les coups d’océan que les typhons soulèvent, le Temple du Rivage posé depuis douze siècles au seuil même des vagues, sur la
côte de Coromandel, estompe doucement le relief de sa pyramide.
Ici est la Cité des Dieux que l’architecte dravidien voulut à l’image de l’Univers. Le granité rose des étages assemblés bloc à bloc sur le sable s’élevait
d’un monde temporel que la terre et l’eau se partagent vers une harmonie supérieure où tout se fond dans le divin.
Après son édification — que rien ne semblait pouvoir battre en brèche — sous le double signe de Brahma le Créateur et de Vishnou le Conservateur, commença
l’érosion des sculptures, jadis grouillantes de vie, puis celle des parois elles-mêmes où le grain de la pierre a presque disparu.
Cette usure du temps n’est-elle pas la volonté de Shiva, dieu destructeur et « Seigneur de la danse », venu pour nous désentraver du lien de l’illusion qu’un temple,
maintenant, sur ce rivage, existe?
Lors de mon enfance mâconnaise j’avais été intrigué par une reproduction en couleurs représentant le panorama d’une ville au bord de la mer, ouverte sur une baie que
surplombait un curieux pic rocheux appelé Pain de sucre. Cette ville, on l’aura deviné, était Rio de Janeiro, un des plus beaux paysages du monde, prétendaient mes parents.
Quand j’ai vu Rio pour la première fois, j’ai été tenté de leur donner raison. Les Cariocas en sont eux-même convaincus puisqu’un de leurs nombreux dictions affirme :
Dieu créa le monde en sept jours mais il en a mis au moins deux pour Rio.
La ville — ou plutôt ses différentes parties — s’inscrit dans un décor de collines pointues ou monos, dont la plus célèbre, avec le Pao de Açucar, est
celle du Corcovado qui, à sept cents mètres d’altitude, sert de socle à la statue monumentale — et laide, vue de près — du Christ protecteur.
Jeune ethnologue ébloui arrivant au Nouveau Monde en 1943, Lévi-Strauss écrira: « Rio est mordu par sa baie jusqu’au cœur; on débarque en plein centre, comme si
l’autre moitié, nouvelle Ys, avait été déjà dévorée par les flots. » L’image est belle mais date un peu puisque aujourd’hui de nombreux terrains, comme
la fameuse bande côtière de Copacabana, ont été conquis sur l’eau, gommant, au moins en partie, cette intrusion de l’océan dans la ville. Une autre intrusion, toute de
misère et de laideur cette fois, est celle des favellas accrochées aux flancs des collines; il semble qu’elles vont dégringoler vers la ville et la submerger.
A Rio comme à Mexico, Bombay ou Singapour, l’opulence côtoie la misère avec une arrogante brutalité. Ici le marbre, la moquette, l’acier; à côté la tôle,
le carton, la boue pour une survie au jour le jour, sans eau, sans électricité, sans égouts; honte de nos sociétés modernes. Quand le Pape vint en visite au Brésil
il manifesta le désir de se rendre dans l’un de ces bidonvilles. Quelques semaines avant son arrivée on le lui prépara sur mesure, en installant à la hâte le
téléphone et l’électricité après avoir ravaudé puis repeint quelques façades. A peine le Saint-Père eut-il tourné le dos, tout fut
démonté, ramené à l’état initial.
Sur un banc de Copacabana, un petit cireur de chaussures est couché en chien de fusil. Sans doute n’a-t-il pas d’autre lit que ce banc ; et puis qui dort dîne. Tels sont les deux
visages de Rio, ville de la beauté toujours blessée. Cela est vrai du pays tout entier.
Jean Orizet
FAISONS-VITE
J‘ai rempli ma boîte-à-peindre-de-campagne
pars, en bretelle l’ordre à rétablir avant qu’il soit trop tard
notre genèse est prête à vivre, accouchons-là
sur l’eau et à compter d’elle
les ors de Salomon sont restés intacts, en tant que ce qu’ils sont à proprement parler, et non en langage matériellement sale d’argent
Ils dorment enfouis, au pied de l’acacia quelque part dans ce désert d’inexistence…
Niala-Loisobleu – 24 Juin 2020










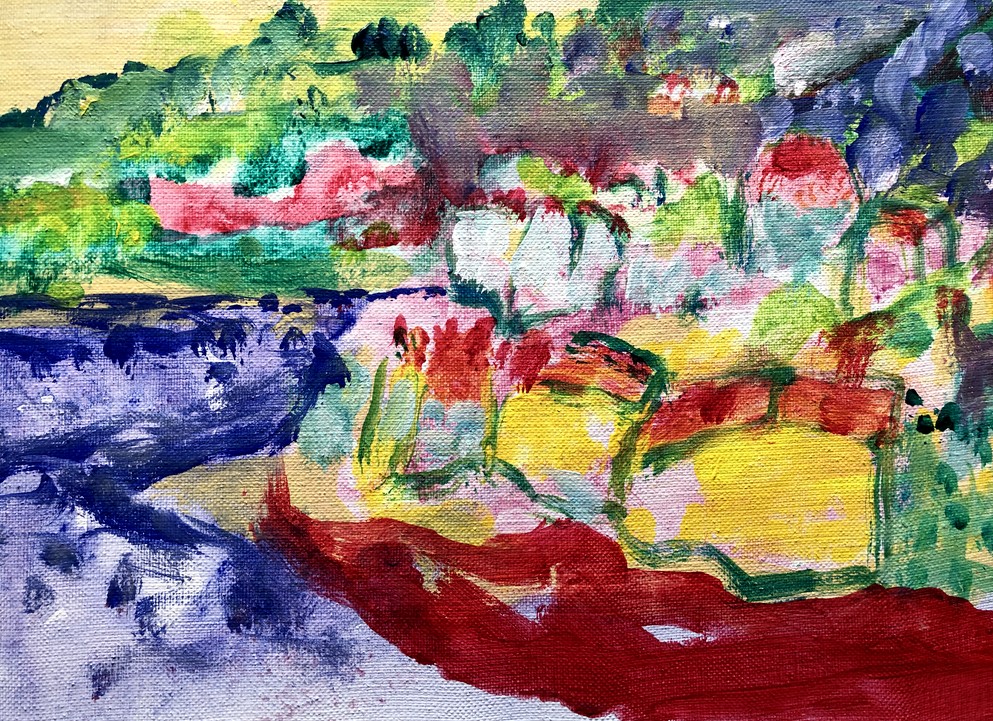
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.